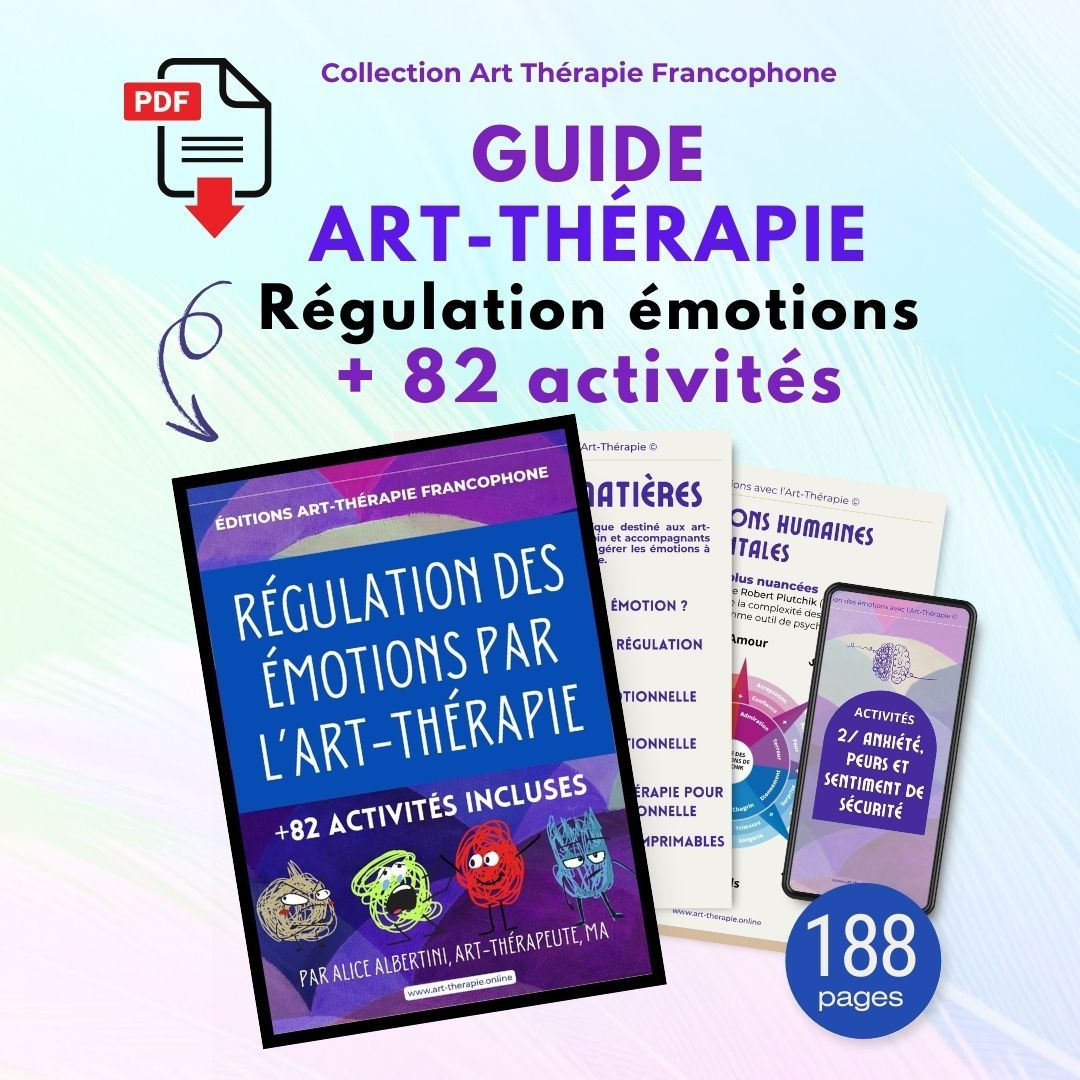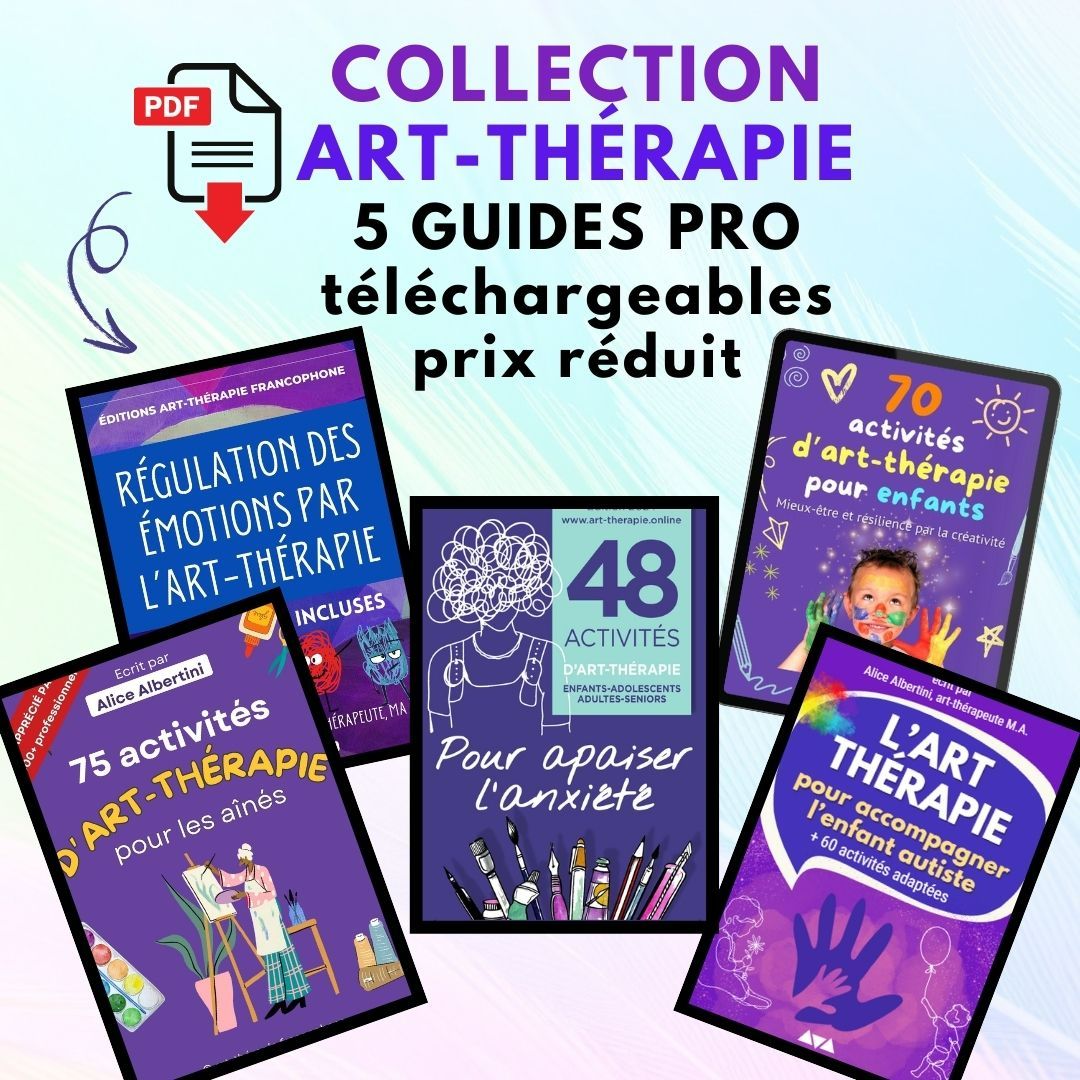L’art-thérapie en périnatalité : entre le lien et l’indicible
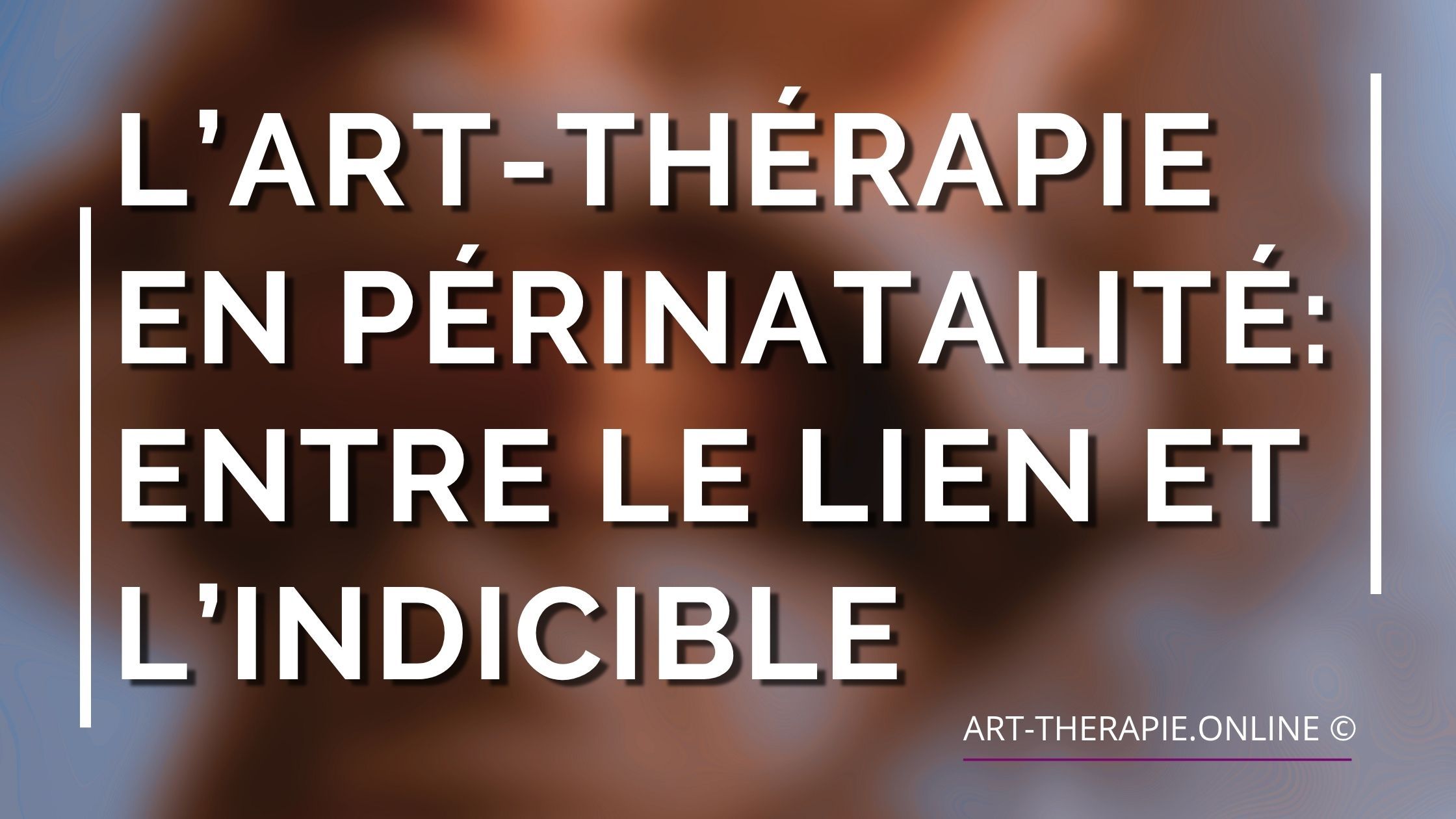
par Alice Albertini, MA, Art-thérapeute – Art-Thérapie Francophone
Recherche par Nathalie Albertini
INTRODUCTION
On prépare les familles à l'accouchement. On parle du plan de naissance, des contractions, de l'allaitement. On prépare beaucoup moins à ce qui arrive après : la secousse émotionnelle, la réorganisation intérieure, la façon dont la maternité (ou la parentalité) nous transforme fondamentalement. Les art-thérapeutes travaillant en périnatalité voient régulièrement cette part dont on parle peu : ce moment où l'on ne se reconnaît pas tout à fait soi-même, où l'on se découvre mère ou parent sans y être encore habitué·e.
La période périnatale — de la grossesse aux premiers mois après la naissance — n'est pas qu'un moment « magique ». C'est une transition très chargée sur les plans physique, psychique, identitaire et relationnel. Elle vient brasser des zones très profondes : la sécurité intérieure, l'histoire familiale, l'image de soi, le rapport au corps, la capacité à demander du soutien. Si c'est le premier enfant, ce passage est si radical qu'il peut mettre à l'épreuve les repères et souvent le sentiment d'être à la hauteur de la tâche.
Dans cet espace de remaniement global, l'art-thérapie peut offrir un lieu précieux où l'on peut se déposer sans se justifier et même nommer ce qu'un parent ne peut pas exprimer ouvertement. L'expression créative devient cet espace d'accueil de l'indicible. Les études réalisées dans les vingt-cinq dernières années confirment la pertinence de l'art-thérapie clinique en ce domaine : les interventions ont un effet positif mesurable sur l'anxiété périnatale, la dépression post-partum et la qualité du lien entre le parent et le bébé (Xu et al., 2024 ; Wang et al., 2023).

LA PÉRINATALITÉ, UN SISMOGRAPHE ÉMOTIONNEL
Un lieu commun prétend que la difficulté de la période périnatale vient « juste » du manque de sommeil. En réalité, la transformation est beaucoup plus large et profonde. La périnatalité réactive les dynamiques d'attachement et les mémoires émotionnelles anciennes. Elle réveille aussi des loyautés familiales, des peurs, des colères héritées. C'est ce que Winnicott décrivait comme une « crise ordinaire »: un état de disponibilité psychique extrême où la mère est traversée par des sensibilités qui la dépassent.
Pour certaines personnes, cette ouverture est vécue comme une forme de puissance douce. Pour d'autres, c'est une perte de repères : sentiment d'étouffement, impression d'effacement en dehors du bébé, peur d'échouer. Beaucoup de mères disent en début de rencontre : "Je ne pensais pas que ce serait si intense. On m'avait dit que j'allais être heureuse, pas que j'allais me sentir mal comme ça."
Les troubles de l'humeur en post-partum sont fréquents. Selon les estimations récentes, entre 10 % et 20 % des mères vivent une dépression post-partum ou une anxiété sévère après la naissance (OMS, 2024). Cela ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leur enfant, mais qu'elles traversent une zone de surcharge où l'identité, le corps et les responsabilités s'entrechoquent.

La chercheuse britannique Susan Hogan décrit bien cette tension dans son article The Tyranny of Expectations of Post-Natal Delight (2017). Elle explique que notre culture impose aux mères un récit figé : celle d'un bonheur évident et lumineux. Toute autre réalité : la fatigue, la colère, l'ennui, le sentiment de claustrophobie, la peur du mal faire, devient un tabou. Hogan parle d'« état liminal », c'est-à-dire un état de seuil : on n'est plus celle qu'on était avant, mais on ne maîtrise pas encore la nouvelle version de soi. Et ce seuil est socialement étroit. Le corps des femmes est médicalisé, commenté, corrigé. La posture de parent idéal : l'allaitement, la récupération physique, la disponibilité émotionnelle… tout devient matière à jugement social ou familial. Cette pression réduite au silence, la véritable souffrance psychologique que vivent certaines.
C'est à cet endroit précis que l'art-thérapie peut faire une différence. Parce que l'art ne demande pas à la personne de réussir quoi que ce soit de joli, ni d'avoir toujours des pensées et des émotions dignes d'un parent idéal.

L'ART-THÉRAPIE COMME APPROCHE DE RÉGULATION ÉMOTIONNELLE
Depuis une vingtaine d'années, les études sur les arts thérapies en périnatalité se sont développées. Une méta-analyse récente menée par Xu et ses collègues (2024) a rassemblé douze essais cliniques de plusieurs pays et a montré que différentes thérapies expressives — incluant la musique, les arts visuels, le mouvement et l'expression dramatique — réduisent de manière appréciable les symptômes de dépression post-partum et d'anxiété. Une autre synthèse, réalisée par Wang et al. (2023), arrivent aux mêmes conclusions : ces approches améliorent le bien-être émotionnel et la qualité de vie globale des parents.
Ce que ces chiffres indiquent, c'est que l'acte créatif, accompagné d'un-e art-thérapeute, agit positivement sur le système nerveux et sur le sentiment d'isolement. Durant une séance d'art-thérapie en périnatalité, on voit le stress redescendre, des regards qui se lèvent enfin vers le bébé ou plus de patience envers soi-même. L'apaisement se produit au niveau somatique. Et souvent, c'est une première que la mère ressent cette détente, depuis l'accouchement.

Un exemple pertinent vient de la musicothérapie périnatale. Lors d'une étude en contexte postnatal (Xi et al., 2024), les musicothérapeutes ont proposé à des femmes en dépression post-partum ceci: quelques minutes par jour d'écoute musicale guidée, entrée sur des séquences sonores lentes, puis l'invitation à fredonner en tenant son bébé. Après six semaines, les mesures de dépression avaient nettement diminué. Les femmes décrivaient une sensation de réappropriation intérieure : « Quand je fredonne, on dirait que ma tête arrête de courir. »
La musique et la voix ne passent pas par le mental. Elles s'adressent au corps, au souffle et agissent sur le rythme cardiaque. Elles permettent de se déposer sans avoir à tout expliquer. Et cela compte énormément pour ces parents qui n'ont pas de mots, ou plus l'énergie de parler.

PRENDRE SOIN DU LIEN : L'ART-THÉRAPIE DYADIQUE
Donald Winnicott disait : un bébé seul, ça n'existe pas (1964). Cela signifie qu'un nourrisson ne peut être compris en dehors de la relation vivante qui l'unité à sa mère (ou à la figure qui s'occupe de lui). L'art-thérapie contient par conséquent des approches qui incluent cette dyade. Dans les années 90 au Québec, l'art-thérapeute canadienne Dre Lucille Proulx, a développé un modèle d'intervention appelé « art-thérapie dyadique parent-enfant », à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Proulx, 2002).
Le principe : plutôt que de travailler uniquement le parent ou l'enfant séparément, on crée un espace où les deux sont présents. Proulx s'appuie sur les travaux sur l'attachement (Bowlby, Ainsworth) et sur la notion des « fantômes dans la crèche », des blessures psychiques non résolues de la mère qui viennent affecter l'attachement avec son enfant. D'après Proulx, cet espace de création en duo permet à ces traces anciennes de se transformer dans un cadre sécuritaire, plutôt que de se jouer au quotidien.
Un exemple de commentaire cela pourrait se passer en séance : une grande feuille est étalée pour que les deux puissent créer. Le parent commence à peindre dans son coin. L'enfant, pose des traces spontanées. Les deux ont cette distance sur la feuille. Ensuite, l'art-thérapeute peut proposer au parent de « suivre le mouvement » de l'enfant, sans essayer du guider. Parfois, il faut du temps avant que l'interaction prenne une forme fluide.

Dans son livre, le Dr Proulx raconte une scène étonnante : un parent épuisé peignait d'un côté de la feuille, l'enfant de l'autre. Le petit âgé de 28 mois, a soudainement tracé une ligne bleue qui reliait leurs deux zones. Proulx décrit cette ligne comme un moment de bascule. Ce trait bleu rend l'attachement visible au parent, malgré son épuisement, malgré sa culpabilité. Cette ligne bleue reliait « leurs expériences affectives dans un espace partagé » et autorisait un contact plus tendre et réparateur (p.64).
Quand la mère ou le père accepte d'entrer dans le geste créatif de petit enfant, il/elle dit inconsciemment : "Je te vois. Je peux te suivre." Et quand le bambin constate que son geste est suivi, respecté, amplifié, il perçoit que ce qu'il fait est reçu et accepté, malgré les difficultés relationnelles. C'est un socle d'attache.
Ces moments ne sont pas seulement touchants, ils sont thérapeutiques. Le Dr Proulx a pu observer une mesurable de la synchronie émotionnelle parent-enfant au fil des séances. Le parent a appris à lire les signaux de l'enfant et à y répondre d'une manière équilibrée et sécurisante (Proulx, 2002). Autrement dit, la co-création visuelle à deux devient un outil concret pour consolider le lien entre l'enfant et son parent.

METTRE DES MOTS SUR L'INVISIBLE : LA PRESSION SOCIALE ET LE DROIT À L'AMBIVALENCE
On ne peut pas parler de périnatalité sans aborder ce qui fragilise les parents aujourd'hui en Occident. Le post-partum se déroule rarement dans un « village » solidaire entourant la jeune mère. Il se déroule souvent dans un appartement, loin de la famille, sous pression, dans une solitude réelle malgré la présence du conjoint. Le corps est encore douloureux, l'allaitement peut être difficile, le sommeil morcelé et la charge mentale écrasante.
En parallèle, l'image sociale de la maternité reste trop lissée. On s'attend à ce qu'une nouvelle maman soit performante, aimante, disponible, heureuse et reconnaissante. Et si elle ne l'est pas, on lui propose des solutions rapides : « Fais confiance à ton instinct », « Profite, ça passe vite », « Tu devrais être heureuse ». Ce qui revient à dire : "Ne viens pas envahir l'espace public avec tes difficultés, car c'est l'enfant qui est le plus important."
L’art-thérapeute britannique Susan Hogan met en lumière ce paradoxe. Dans ses séances avec des jeunes mamans, elle remarque que la maternité est souvent présentée comme une félicité, mais vécue comme une période de forte vulnérabilité, parfois d’oppression intérieure. Elle parle d’un mélange de “claustrophobie, de culpabilité et de ressentiment”, que beaucoup de mères reconnaissent, sans oser l’avouer (Hogan, 2017). Elle décrit aussi à quel point l’injonction à la joie maternelle, cette idée que l’amour doit tout absorber, tout effacer est une forme de violence.

L’art-thérapie, ici, devient un lieu de désobéissance symbolique. On peut peindre sa peur sans se censurer. On peut exprimer “je suis fatiguée d’être touchée tout le temps”. On peut modeler la colère sans qu’on nous dise qu’on est “ingrate”. On peut traduire l’ambivalence, la beauté et l’épuisement dans le même espace, sans avoir besoin de choisir une seule histoire à raconter.
L’art-thérapeute québécois Jean-Marc Péladeau déclarait « on ne cherche pas à faire du beau, on cherche à faire du vrai en art-thérapie. » et pour beaucoup de mères, retrouver cette authenticité, sans jugement peut leur permettre de soulager la pression et les émotions lourdes qui les accablent.

DES MÉDIATIONS DIFFÉRENTES POUR DES BESOINS DIFFÉRENTS
Toutes les médiations artistiques ne travaillent pas la même chose.
Le travail en modalités plastiques comme le dessin, la peinture, le collage, l’argile ou le textile permet de poser l’émotionnel en dehors de soi, de le rendre visible, manipulable et contenant. De placer une distance. Cela est utile en période de surcharge ou après un événement difficile. Dans les situations de deuil périnatal ou de perte, par exemple, la création d’un objet-mémoire (une boîte, une image, une empreinte) aide à reconnaître l’existence du bébé perdu et à maintenir un lien symbolique vivant, sans rester figé. Des travaux récents avec des femmes ayant vécu un deuil périnatal montrent que quelques séances d’art-thérapie peuvent les aider à améliorer leur qualité de vie et à diminuer l’intensité du chagrin (Zahmatkesh et al., 2024).
La musique et la voix, elles, permettent la régulation d’émotions fortes. On le voit chez les mères en post-partum: le simple fait de fredonner à tempo lent en berçant le bébé réorganise la respiration et apaise le système nerveux. Les études de Fancourt et Perkins (2018) ont montré que des ateliers de chant postnatal, où des mères chantent ensemble avec leurs bébés, aident à la diminution des symptômes dépressifs. La voix devient alors une ressource intérieure disponible en tout temps.

En dramathérapie, cette étude réalisée en Israël (Feniger-Schaal, Koren-Karie & Bareket, 2013) a proposé des improvisations et des mises en scène à des mères à risque de négligence auprès de leur enfant avec pour objectif de soutenir l’attachement. Après 10 semaines, les participantes ont développé une meilleure empathie, compréhension et sensibilité face aux besoins affectifs de leur enfant. Cette approche favorise un renforcement du lien d’attachement, une diminution du stress parental et une plus grande conscience de soi dans la relation mère-enfant.
Enfin, la danse et le mouvement sont des modalités précieuses pour réhabiter son corps après une grossesse, qui l’a mis à l’épreuve et beaucoup transformé. Beaucoup de mères ont le sentiment d’être dépossédées d’une part vitale de leur essence. Les ateliers de mouvement périnatal ne sont pas forcément sportifs. Souvent, ce sont quelques pas lents, des balancements, le droit de ressentir son corps sans jugement. On redécouvre un rapport tendre à son propre corps, plutôt qu’un rapport strictement fonctionnel (“Est-ce que je produis assez de lait ?”, “Est-ce que j’ai déjà perdu mon ventre ?”). Cette réappropriation corporelle soutient énormément l’estime de soi et diminue l’auto-culpabilisation.

POURQUOI CELA COMPTE
Ce que disent toutes ces approches art-thérapeutiques, c’est qu’en périnatalité, prendre soin de soi sans forcément avoir à parler n’est pas un luxe. C’est un soin psychique pour la mère, un soin relationnel pour la dyade parent-enfant, et parfois même un soin collectif, lorsqu’en groupe, on découvre qu’on n’est pas seul-e à vivre ces difficultés et éprouver des émotions interdites aux parents idéaux.
Les art-thérapeutes professionnels ne disent jamais aux mamans qu’elles devraient "passer à travers", ni “penser positif". Il existe un espace créatif ou elles peuvent exprimer tout ce qu’elles vivent sans jugement ou performance, via l’image et les processus créatifs. Cela est valable aussi pour les papas. Cet espace accueille aussi la famille qui peut se retrouver autrement, par le jeu, que dans la gestion exigeante du quotidien. L’espace de l’art-thérapie peut aider les parents à se sentir suffisamment bons, comme aurait dit Winnicott (1964). Pas parfaits, pas idéaux, mais assez bons pour permettre à l’enfant de grandir en santé.
Demander de l’aide est déjà un premier pas. Quand une mère apprend à réguler son anxiété, quand elle ose nommer son ambivalence sans honte, elle se donne les outils pour devenir cette mère imparfaite, mais suffisamment bonne. Et elle transmet déjà quelque chose de sain à son enfant. Elle lui transmet l’idée qu’on peut avoir des émotions compliquées et être capable de prendre soin de son enfant. Qu’on peut traverser des moments difficiles tout en appréciant ce rôle parental duquel on ne peut pas prendre de congés.

CONCLUSION
L’art-thérapie en périnatalité touche à trois niveaux. Elle soutient la santé mentale du parent, en diminuant l’anxiété et la dépression post-partum (Xu et al., 2024 ; Wang et al., 2023 ; Xi et al., 2024). Elle aide à consolider le lien d’attachement, en restaurant une forme de sécurité mutuelle, comme l’a montré Dr Lucille Proulx sur l’art-thérapie en dyade (Proulx, 2002). Enfin, elle redonne une place au véritable vécu émotionnel des mères face aux injonctions de perfection sociale que décrit Susan Hogan (2017).
La période périnatale est un rite de passage radical pour les nouveaux parents, qui ont souvent besoin d’aide en ces temps où le village et la famille élargie ne sont plus là pour les entourer. En clair : l’art-thérapie redonne de l’espace, du recul et du soutien, de manière créative lors de cette période délicate où le bébé demande une grande disponibilité de ses parents.
Parce que devenir parent n’est pas juste “accueillir un bébé”. C’est aussi se ré-ajuster soi-même dans ce nouveau rôle, dans un corps nouveau, un lien à façonner, ces émotions particulières et cette responsabilité parfois vertigineuse. L’art-thérapie est ce lieu d’accueil créatif où la mère, le co-parent et l’enfant peuvent se trouver autrement : dans la couleur, dans le mouvement, dans la voix, dans le jeu. L’art-thérapie permet un protocole de soin adapté à la famille et au bien-être du bébé, sans forcément avoir besoin de parler pour aller mieux. Une berceuse, un gribouillis partagé, ou exprimer les sentiments interdits autrement, tout cela fait partie de l’art-thérapie adaptée à la périnatalité.
D'autres articles de Blogue qui pourraient vous intéresser:
Régulation émotionnelle par la création: les bienfaits de l’art-thérapie
Comment l'art-thérapie apaise (vraiment) l'anxiété
L’écosystème de la séance d’art-thérapie plastique
L'art-thérapie, au service du développement de l'enfant
RÉFÉRENCES
- Fancourt, D., & Perkins, R. (2018). Effect of singing interventions on symptoms of postnatal depression. British Journal of Psychiatry, 212(2), 119-121.
- Feniger-Schaal, R., Koren-Karie, N., & Bareket, M. (2013). Dramatherapy focusing on maternal insightfulness: A preliminary report. The Arts in Psychotherapy, 40(2), 185-191.
- Hogan, S. (2017). The Tyranny of Expectations of Post-Natal Delight: Gendered Happiness. Journal of Gender Studies, 26(1), 45–55.
- Organisation mondiale de la santé. (2024). Perinatal mental health and maternal well-being: global report.
- Proulx, L. (2002). Strengthening Emotional Ties Through Parent-Child Dyad Art Therapy. Jessica Kingsley Publishers.
- Wang, M., et al. (2023). Art-based interventions for women’s mental health in pregnancy and postpartum: A meta-analysis of RCTs. Frontiers in Psychiatry, 14, 1112951.
- Winnicott, D. W. (1964). The Child, the Family, and the Outside World. London: Penguin Books
- Xi, L., et al. (2024). Receptive music therapy for postpartum depression: A controlled clinical study. Complementary Therapies in Medicine, 83, 102890.
- Xu, J., et al. (2024). Art-thérapie créative pour la dépression post-partum : revue systématique et méta-analyse. Complementary Therapies in Clinical Practice, 57, 101886.
- Zahmatkesh, M., et al. (2024). Le rôle de l'art-thérapie sur la qualité de vie des femmes ayant récemment subi une perte de grossesse : un essai clinique randomisé. PLoS ONE, 19(7), e0305403.
Références en français:
Article sur l'art-thérapie pour les grossesses difficiles (Par Mette Galatius) :
Quelle place pour l'art-thérapie dans un service de grossesses pathologiques ?
Depuis 2018, une étude de Petra Hüppi et Dc Manuela Filippa, hôpitaux de l'université de Genève. Article sur l'effet de la musique sur le cerveau des prématurés : La musique aide le cerveau des grands prématurés à se construire
Thèse pour un atelier d'art-thérapie pour mère et leur enfant :
(Ces de fin d'études, par Delphine Dewachte)
Thèse sur l'art-thérapie, soin soutien à des mères en situation de vulnérabilité :
(Thèse de fin d'étude, par Hélène Cabrera-Begu)
(Par Sarah Puvilland et A. Rideau )