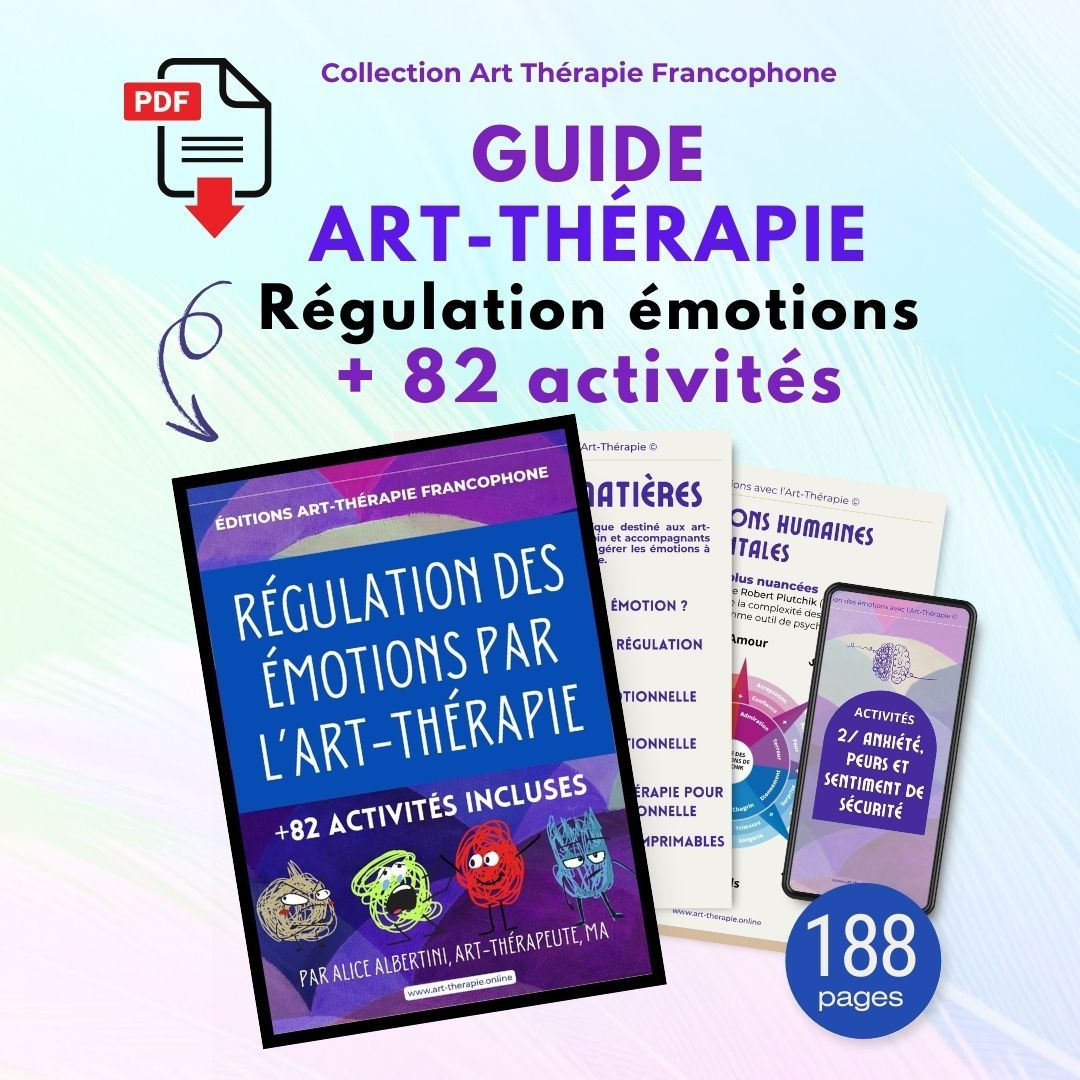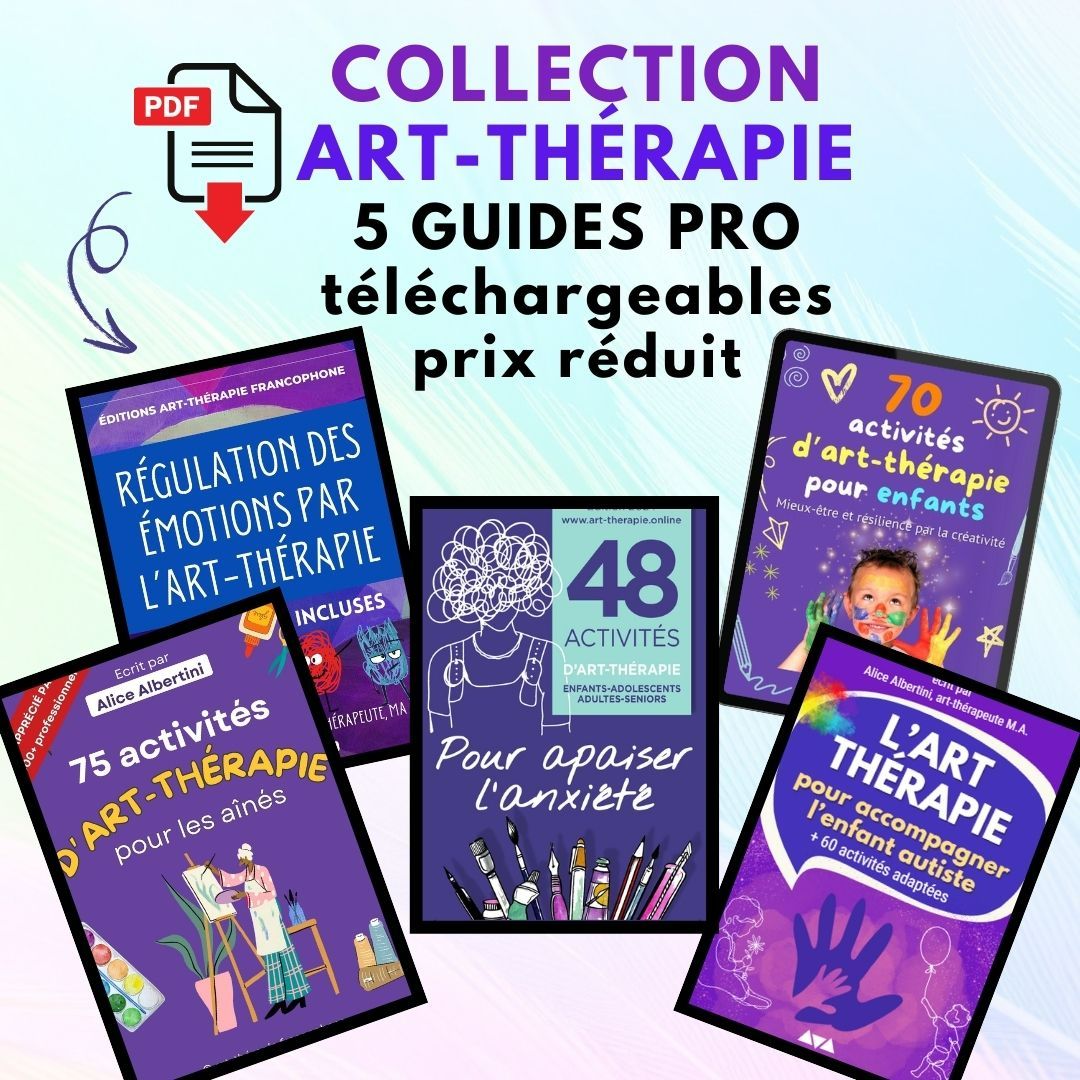L’écosystème de la séance d’art-thérapie plastique

L’écosystème de la séance d’art-thérapie plastique
Écrit par Alice Albertini, art-thérapeute MA.
Introduction
Lorsqu’on s’intéresse à l’art-thérapie, une question revient souvent : quels sont les ingrédients essentiels d’une séance d’art-thérapie ? Est-ce la créativité du client, l’expertise spécifique de l’art-thérapeute, ou le langage de l’image qui sont les plus importants?
En réalité, une séance d’art-thérapie repose sur un mélange subtil de quatre éléments : le client, l’art-thérapeute, la création et les matériaux. Ensemble, ils forment un écosystème vivant, où chaque élément influence et nourrit les autres.
Caroline Case, Tessa Dalley et Dean Reddick (2023) décrivent ce processus comme « une relation à trois voies entre le client, le thérapeute et l’image » — une triangulation vivante à laquelle s’ajoute aussi un quatrième protagoniste: le matériau lui-même.
Judith Rubin, pionnière américaine en art-thérapie, voyait dans l’image « une médiation entre le visible et l’invisible (2005) . En France, Jean-Pierre Klein insiste quant à lui sur la création comme acte de symbolisation vivante (2012). Entre ces deux traditions — anglo-saxonne et française — émerge l’art-thérapie professionnelle comme rencontre incarnée, où la matière, la relation humaine et l’image convergent.
Cet article propose d’explorer ces fondements de la séance d’art-thérapie idéale, à travers la place du client, la présence de l’art-thérapeute, la puissance de la création et l’influence des matériaux.

Définir l’art-thérapie : entre création, soin et relation
Selon The Handbook of Art Therapy (Case, Dalley & Reddick, 2023), l’art-thérapie se définit comme une forme de psychothérapie qui utilise le médium artistique comme principal mode de communication. Ce processus est facilité par un-e art-thérapeute professionnel-le. L’art-thérapie se distingue donc d’une thérapie basée sur la parole uniquement. Elle repose sur une dynamique triangulaire — entre le client, l’art-thérapeute et l’image créée — qui permet l’avancée thérapeutique. Contrairement à une démarche esthétique ou à une interprétation de l’image, le but n’est pas de « faire du beau », mais d’accompagner le processus de changement personnel. Le rôle de l’art-thérapeute est d’offrir ce cadre où la personne peut donner forme à ce qui est difficile à dire, et ainsi rétablir des ponts entre le vécu émotionnel, le corps et la pensée. Ainsi, l’art-thérapie émerge dans cet espace intermédiaire pour favoriser la croissance psychique de la personne (Case, Dalley & Reddick, 2023).
Médecin psychiatre, dramaturge et écrivain, Jean-Pierre Klein est l’un des pionniers de l’art-thérapie en France depuis les années 70. Il conçoit l’art-thérapie comme une rencontre entre l’art, la symbolisation et le soin. Il défend une approche humaniste, poétique et clinique, centrée sur la transformation de l’être par le processus créatif.
Pour Jean-Pierre Klein (2014), « L’art-thérapie est une méthode de soin psychique qui consiste à favoriser l’expression symbolique à travers un médium artistique, afin de permettre au sujet de se recréer lui-même. »

Le/la client-e : au cœur du processus thérapeutique
Le premier fondement d’une séance d’art-thérapie est le client — non pas un bénéficiaire passif, mais engagé dans sa démarche. Tout part de lui : son rythme, ses résistances, sa disponibilité à s’exprimer avec les matériaux d’art.
Selon The Handbook of Art Therapy (Case, Dalley & Reddick, 2023), chaque client entre en séance avec son histoire, son imaginaire et sa propre relation à l’image. Le rôle de l’art-thérapeute n’est pas d’interpréter l’œuvre, mais de faciliter un processus qui permette au client de donner forme à ce qui restait indicible. Cette approche « offre l’opportunité d’une communication et d’une transformation personnelle, particulièrement précieuse pour ceux qui peinent à exprimer leurs émotions verbalement » (Case et al., 2023).
Le client est donc co-créateur du cadre thérapeutique. Son engagement, même discret, influence la profondeur et le rythme du travail. Certains viennent chercher un apaisement immédiat ; d’autres explorent lentement les matériaux. En peignant, modelant ou assemblant, le client met en mouvement ce que les mots ne disent pas. Ce qui apparaît sur le papier n’est pas une simple représentation, mais une élaboration émotionnelle.
Case, Dalley et Reddick (2023) soulignent que l’art-thérapie aide à explorer la frontière entre le conscient et l’inconscient. Le client revisite des souvenirs, se réapproprie son histoire et retrouve le plaisir de créer, ce qui a un effet sur lui.
En France, Jean-Pierre Klein partage cette vision. Pour le client, créer devient un acte de renaissance symbolique : en manipulant la matière, la personne retrouve son énergie vitale et son pouvoir d’agir.
Le lieu, la présence de l’art-thérapeute et les matériaux forment un contenant psychique où le client peut se déposer. Case et Dalley (2023) rappellent combien la régularité de ces repères transforme la séance en un espace de jeu — au sens de Winnicott — où la créativité peut émerger régulièrement.
Au fil des séances, le client apprend à regarder son œuvre avec curiosité, à reconnaître ses émotions sans se condamner. L’image devient alors un outil de conscience, un espace d’intégration. Pour Klein, « la création est thérapeutique quand elle rend le sujet créateur de lui-même » (2012). Par le dialogue avec ses images, le client reconstruit son rapport à lui-même et au monde.
Ainsi, le client est le cœur vivant de la séance d’art-thérapie. Son engagement créatif donne sens à tout le dispositif. L’art-thérapie lui offre un lieu où être, sentir et se dire autrement — un espace où il peut redevenir l’auteur de son propre récit.

L’art-thérapeute : gardien-ne du cadre
Si le client est au centre du processus, l’art-thérapeute en est la présence contenante. Elle* garde le cadre, témoigne du processus et agit comme médiatrice entre le visible et l’invisible. Son rôle dépasse l’animation d’une activité : elle crée un espace de permission pour que le client puisse aller mieux à travers la création libre.Elle* est la gardienne du cadre, témoigne du processus de création et agit comme médiatrice entre le visible et l’invisible. Son rôle dépasse la simple animation: elle crée un espace particulier de permission pour que le client puisse aller mieux, via l’invitation à créer librement.
Selon The Handbook of Art Therapy (Case, Dalley & Reddick, 2023), l’art-thérapeute est une facilitatrice du processus créatif et psychique. Sa formation associe pratique artistique, compréhension psychologique et supervision clinique. Ce double ancrage lui permet d’accompagner l’expression du client sans s’y perdre. Elle observe et soutient l’émergence des images avec patience et sensibilité esthétique.
L’art-thérapeute n’est ni une enseignante ni une observatrice passive. Son regard soutenant, sans intrusion, autorise le client à exister dans sa création. Elle incarne le contenant psychique, garant du cadre, du temps de séance et de la confidentialité.
Jean-Pierre Klein rejoint cette vision : l’art-thérapeute est une accoucheuse de sens. Elle ne dirige pas le processus, mais l’accompagne. Son rôle est de permettre au geste créatif de devenir métaphore, de faire passer du ressenti à la forme.
L’art-thérapeute évolue dans un entre-deux : entre création et psychothérapie, entre expression et soin. Elle reste assez proche pour offrir un miroir, assez distante pour préserver l’autonomie du client.
Klein (2014) parle d’un tiers symbolisant : l’art-thérapeute n’est ni psychologue classique ni enseignante en arts, mais une médiatrice entre l’inconscient et la forme créée. Elle accepte de ne pas savoir dans le processus, mais elle l’observe. Elle est, selon ses mots, « une artisane du vivant, une accompagnante du geste créateur. ».
C’est la qualité de présence qui compte le plus. Par sa constance, son attention corporelle et son écoute, l’art-thérapeute crée un climat de sécurité qui rend possible la traversée des résistances.
Klein considère que la rencontre elle-même est un acte créateur partagé : l’art-thérapeute se laisse toucher par ce qui surgit. Elle perçoit la dimension esthétique du processus, non dans la beauté, mais dans la justesse de ce qui se vit. Rubin (2005) parle de l’art-thérapeute comme un « témoin sensible, capable de relier l’expérience créative à l’expérience intérieure. »
Être art-thérapeute, c’est aussi un engagement éthique. Il n’y a pas de thérapie sans thérapeute. Ainsi, la création ne devient thérapeutique que dans un cadre bienveillant, sans jugement ni interprétation hâtive. « L’art-thérapeute ne guérit pas, elle facilite un processus où le sujet se soigne lui-même » (Case et al., 2023).
Klein (2014) conclut avec justesse : « L’art-thérapeute n’est pas celle qui éclaire, mais celle qui allume la lampe du patient. » Par sa présence, elle offre au client la possibilité de devenir auteur de ce qui le traverse, transformant chaque séance en un espace de liberté et de sens.

La création : le tiers vivant du processus
La création est l’aspect qui distingue l’art-thérapie de toutes les autres thérapies verbales. Elle constitue ce tiers vivant qui rend la rencontre entre le client et lui-même possible. Elle agit comme un pont entre le monde intérieur et extérieur, entre le ressenti et la parole.
Case, Dalley et Reddick (2023) rappellent que la présence d’une pièce tangible distingue l’art-thérapie des psychothérapies verbales. La création devient cet espace de projection, où émotions et souvenirs peuvent se déposer sans envahir le client. Grâce à la distance qu’elle procure, la création sert de contenant externe, très utile pour des contenus trop intenses pour être verbalisés.
En manipulant la matière, le client met en mouvement son monde intérieur. Les gestes, les couleurs et les textures deviennent des médiateurs entre le corps et l’émotion.
La création est une partenaire centrale du processus thérapeutique. Elle permet que le client y projette ses difficultés sans crainte. L’image créée devient alors compagne de la résilience, un espace de liberté où la personne retrouve le pouvoir d’agir sur son monde intérieur. Elle représente aussi l’expression de la vitalité créative, ce qui donne souvent de la fierté ou de la surprise : « c’est vraiment moi qui ai créé cela? » demande-t-elle.
La création, en ce sens, est une expérience du vivant : imprévisible, sensorielle, souvent surprenante. Elle reconnecte le corps, la pensée et l’émotion.
Case et Dalley (2023) décrivent l’œuvre créée comme un tiers symbolisant, un miroir qui permet au client de se voir à distance, sans confrontation directe. L’image devient un médiateur neutre entre le client et l’art-thérapeute. Elle conserve la mémoire du processus, trace d’un chemin intérieur souvent invisible.
Parfois inachevée, l’œuvre garde ouverte la suite. Klein (2012) écrit : « L’œuvre n’est pas un produit, mais un passage. Elle ouvre une porte entre le dedans et le dehors, entre le cri et la parole. » L’art-thérapeute, témoin attentif, veille à ce que cette production reste un lieu d’expression authentique, jamais un objet de jugement.
Créer, en art-thérapie, n’est pas « faire du beau », mais permettre à l’expression de se montrer telle qu’elle est. Dans un simple trait ou une tache, quelque chose se dit pour la première fois. Case et Dalley (2023) soulignent que ce processus s’inscrit dans la durée : revisiter son œuvre, la modifier, dialoguer avec elle crée une continuité psychique, un fil reliant les fragments de soi.
Ainsi, la création est bien plus qu’un support : elle est l’articulation même de l’art-thérapie, l’espace où la transformation prend forme et où l’humain se découvre capable de transformer sa souffrance en beauté.

Le matériel artistique: un quatrième mousquetaire.
En marge du client, de l’art-thérapeute et de la création, les matériaux forment le quatrième élément majeur d’une séance d’art-thérapie. Ils ne sont pas de simples outils : ils forment un langage à part entière, donnant des informations précieuses sur le vécu du client.
Comme le souligne Lisa D. Hinz (The Wiley Handbook of Art Therapy, 2015), la maîtrise des médias plastiques distingue l’art-thérapeute des autres professionnels: comprendre leurs propriétés et leurs effets est une responsabilité importante qui ne peut être improvisé. Chaque matériau a un potentiel thérapeutique — mais aussi des limites s’il est mal utilisé. Comprendre leurs propriétés est une responsabilité essentielle.
Un repère essentiel est le Continuum des Thérapies Expressive (CTE) (Kagin & Lusebrink, 1978). Les médias résistants (crayon, collage, bois) offrent structure et contrôle, favorisant une élaboration contenante. Les médias fluides (aquarelle, encres, argile) stimulent les émotions et le lâcher prise. Le support influence aussi l’expérience : un petit papier épais rassure, tandis qu’un grand format ou une toile lisse invite au geste plus ample et actif.
Chaque famille de matériaux ouvre une voie thérapeutique spécifique. En 2D, tracer sur une surface plane et superposer engage la pensée visuelle. En 3D, modeler la terre ou du fil de fer mobilise le corps et aide à se reconstruire. Le collage, très facile permet d’assembler des fragments d’images comme on assemble des fragments de soi. La photographie invite à cadrer sa vision et transformer son regard. Quant aux médias numériques, ils démocratisent la création et offrent de nouvelles formes qui invitent la technologie comme co-créatrice du processus.
Hinz souligne aussi l’importance des médias non conventionnels — objets trouvés, textiles, livres altérés, matériaux de récupération. Les tissus évoquent souvent l’attachement et la sécurité ; les objets récupérés favorisent la revalorisation de soi, en transformant le « rebut » en œuvre. Le fait d’explorer des médiums inhabituels peut aider le client à développer sa créativité et sa capacité à trouver des solutions.
Les matériaux sont des partenaires très actifs. Ils résistent, cèdent, surprennent et soutiennent. Trop fluides, ils peuvent déborder le centre émotionnel; trop structurants ils vont limiter la spontanéité du client. Le rôle de l’art-thérapeute est de doser : format, quantité, durée, rituel, adapté à son client.
Ainsi, le matériau est bien plus qu’un support de projection: Dans sa texture, sa densité ou ses surprises, il offre au client une expérience tangible du changement — une manière d’explorer, de ressentir et de se réinventer.

La synergie entre les quatre dimensions
Lorsque le client, la création, l’art-thérapeute et les matériaux s’articulent, la séance devient un véritable organisme, où chaque partie active les autres. Le client apporte son histoire, ses émotions, son désir (conscient ou non) de transformation. La création agit comme miroir et métaphore, donnant forme à l’indicible. L’art-thérapeute maintient le cadre, accompagne le processus et reste en résonance avec son client et l’oeuvre. Quant aux matériaux, ils ajoutent une présence variée sensible à la triade déjà en place.
Finalement, le résultat est plus vaste que la somme de ses 4 parties. Comme le rappellent Case et Dalley (2023), « l’art-thérapie n’est pas seulement une expression de soi, mais une relation triangulaire vivante entre le client, le thérapeute, l’image — et la matière qui les relie. » et nous allons ajouter les matériaux plastiques en plus à cette séance.
Conclusion
Il n’existe pas de séance « idéale » d’art-thérapie plastique, mais ces quatre dimensions sont essentielles pour qu’elle se passe le mieux possible:
– Le ou la client-e, est le sujet qui vient chercher de l’aide ;
– L’art-thérapeute, qui est la gardienne de l’espace thérapeutique;
– La création, qui révèle un langage médiateur entre le monde intérieur et visible ;
– Et les matériaux, compagnons influents, qui apportent d’autres informations à la séance.
Quand ces éléments s’accordent, la séance devient un espace vivant de transformation. Comme le rappelle Rubin (2005), « l’art-thérapie est une relation entre l’artiste, l’œuvre et le témoin », à laquelle s’ajoute la matière, médiatrice du sensible. Klein (2012) écrivait : « L’acte de créer permet de se recréer. »
Ainsi, l’art-thérapie n’est ni une activité artistique ni une psychothérapie verbale seulement. C’est une poétique du vivant, où la main, la matière et la relation entre client et art-thérapeute se rencontrent pour amplifier la capacité de l’être à se transformer par la création.
Autres articles de Blogue reliés:
Comment se déroule une séance individuelle d'art-thérapie
*Le pronom de l’art-thérapeute dans cet article est au féminin.
Étant donné que 90% des art-thérapeutes sont des femmes, c’est le féminin qui l’emporte.
Références
Case, C., Dalley, T., & Reddick, D. (2023). The Handbook of Art Therapy (4ᵉ éd.). Routledge.
Hinz, L. D. (2016). Media Considerations in Art Therapy: Directions for Future Research, in The Wiley Handbook of Art Therapy (pp. 170–196). Wiley-Blackwell.
Klein, J.-P. (2012). Penser l’art-thérapie. Presses Universitaires de France.
Klein, J.-P. (2014). Initiation à l'art-thérapie: découvrez-vous artiste de votre vie. Marabout
Rubin, J. A. (2005). Artful Therapy. John Wiley & Sons.
Winnicott, D. W. (1971). Playing and Reality. Tavistock Publications.