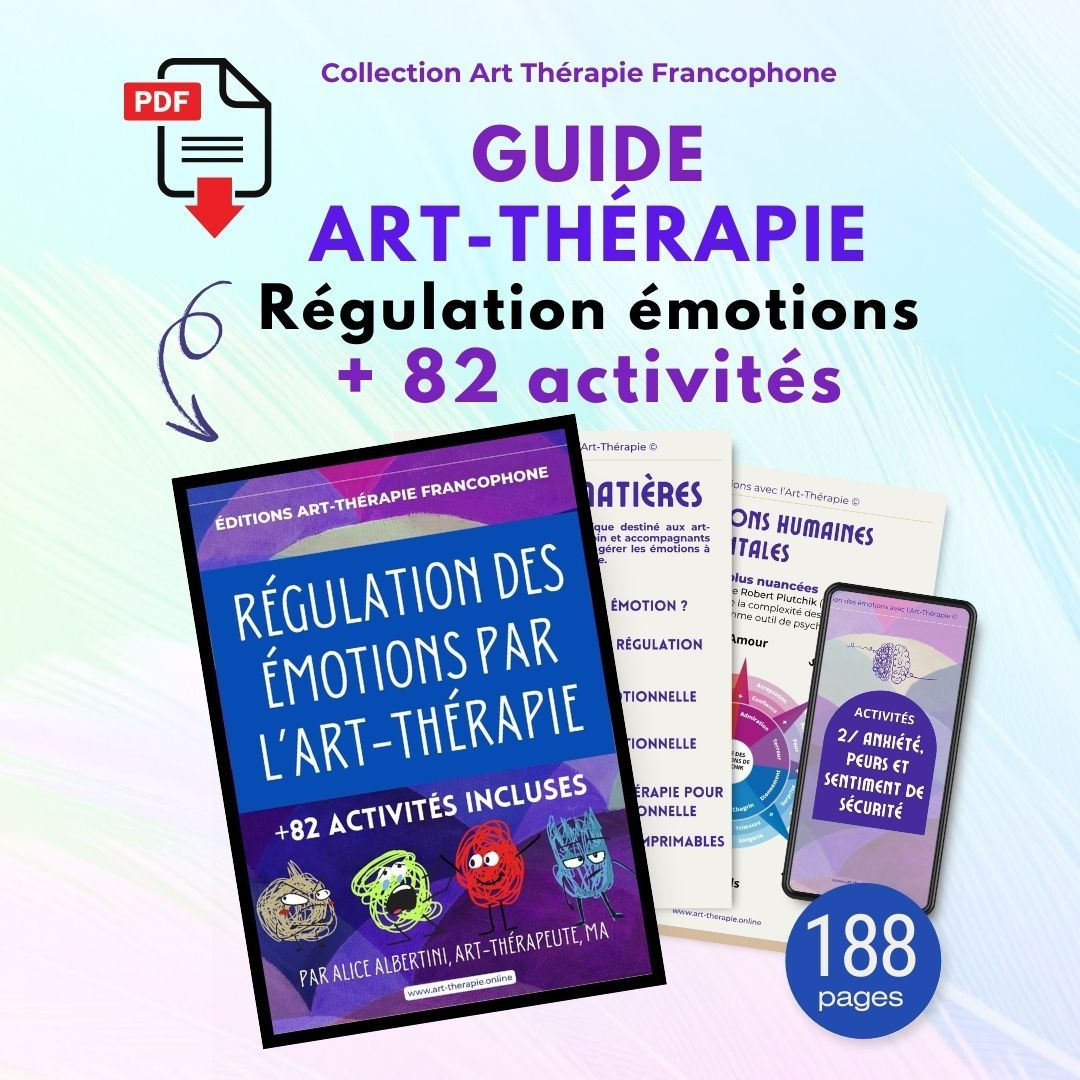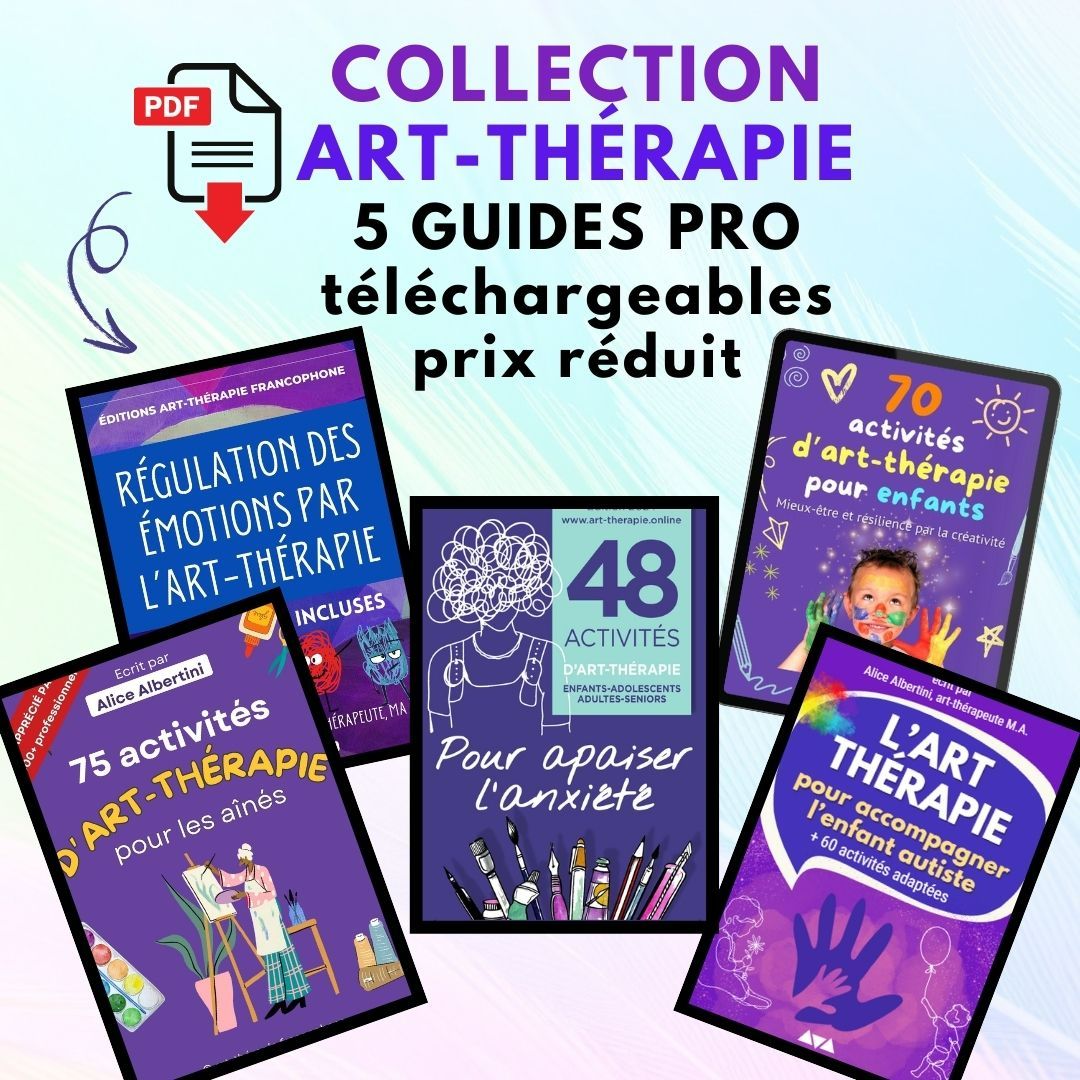S’exprimer autrement : l’art-thérapie avec les enfants autistes

Écrit par Alice Albertini, art-thérapeute MA.
L'art-thérapie décrite dans cet article est à modalité arts plastiques.
La salle est silencieuse, baignée d'une lumière douce. À côté d'un petit garçon absorbé par son dessin, l'art-thérapeute est là, sans brusquer, sans imposer. Elle ne parle pas. Elle regarde, elle accompagne. L'enfant est sur le spectre de l'autisme, et cet espace de création devient pour lui un lieu sûr, où il peut exister à son rythme, avec ses codes. Ce moment-là n'a rien d'anodin : il illustre la puissance d'une relation thérapeutique basée sur la présence, le respect du monde intérieur, et l'accès à une forme d'expression non verbale.
Pourquoi s'intéresser à l'art-thérapie dans le champ de l'autisme aujourd'hui ? Parce que les besoins sont immenses. Parce que les approches traditionnelles échouent parfois à créer un véritable lien. Parce que de plus en plus de professionnels recherchent des modalités alternatives, sensibles, ancrées dans le corps, l'image et l'émotion.
Cet article vise à informer, sensibiliser et documenter les pratiques actuelles en art-thérapie - arts visuels - auprès d'enfants sur le spectre de l'autisme. À partir d'études de cas, de recherches nord-américaines et de références solides, nous explorons comment la création devient un espace d'expression thérapeutique pour ces enfants.

Comprendre l'autisme chez les enfants
Les troubles du spectre de l'autisme (TSA) sont définis dans le DSM-5 (APA, 2013) comme un ensemble de troubles du neurodéveloppement caractérisés par des difficultés persistantes dans la communication sociale et les interactions , ainsi que par des comportements répétitifs et restreints, souvent accompagnés d'une hypersensibilité sensorielle et d'un fort besoin de routines. Selon un article de la Presse, une étude de 2019 montre qu'un enfant canadien (de 1 à 17 ans) sur 50, soit 2% avait reçu un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme.
On parle d'un spectre , car il existe une grande hétérogénéité dans les profils, les capacités cognitives, langagières, émotionnelles et sensorielles parmi les petits patients. Certains enfants ne parlent pas, d'autres développent un langage sophistiqué. Certains ont une intelligence verbale élevée, d'autres un retard de développement global. Cette diversité appelle une approche individualisée et respectueuse. Voici les principaux défis rencontrés:
Langage et communication :
Les enfants autistes peuvent présenter un langage non verbal, limité ou atypique. Même ceux qui s'expriment oralement peuvent avoir du mal à comprendre le second degré, l'humour et peuvent peiner à exprimer leurs besoins de manière à être compris. L'utilisation du contact visuel peut également être un défi (Aithal & Karkou, 2023).
Relations sociales et réciprocité émotionnelle :
L’autisme peut affecter la capacité sociale, ce qui leur cause souvent des difficultés à l’école. Certains enfants semblent préférer être seuls, mais cela reflète souvent une difficulté à saisir les codes sociaux. Ils peuvent également avoir de la difficulté à interpréter les expressions faciales, les gestes ou le ton de la voix, ce qui nuit à leur manière de réagir adéquatement (Ferris, 2020).
Rigidité cognitive, routines et comportements répétitifs :
Le besoin de routines prévisibles est fréquent. Des changements inattendus peuvent générer de l’angoisse, parfois exprimée par des crises ou du retrait. Les comportements répétitifs (mouvements, rituels, obsessions pour certains objets ou sujets) peuvent aider à calmer l’anxiété et à structurer le monde interne.
Sensibilité sensorielle accrue ou atypique :
Certains enfants autistes réagissent intensément à des stimuli sensoriels : bruits soudains, textures, odeurs ou lumières vives peuvent être vécus comme intenses voire insupportables. D’autres peuvent rechercher activement des stimulations (par exemple, se balancer, toucher des objets). Cela peut avoir un impact important sur la participation aux activités scolaires ou sociales (American Psychiatric Association – DSM-5, 2013).
Comorbidités fréquentes :
L’autisme est souvent accompagné d’autres troubles comme l’anxiété généralisée, le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), la dyspraxie, les troubles du sommeil ou trouble de l’alimentation. Ce faisant, l’approche de soin a besoin d’être holistique et individualisée pour chaque enfant (Malchiodi, 2011).
Nous avons une grille d'observation pour établir le profil sensoriel de l'enfant, avec les matériaux, destiné aux art-thérapeutes. Cliquez ici pour en savoir plus.

Ces défis ont des répercussions certaines sur la vie scolaire, les relations familiales et l’équilibre émotionnel de l’enfant. Les familles vivent souvent une fatigue chronique liée au manque d’information, à la vigilance constante et à la difficulté d’accès à des services spécialisés.
L’art-thérapie, justement, permet à ces enfants de créer dans un langage qui leur est propre, en respectant leur rythme, leurs perceptions et leur monde sensoriel singulier (Malchiodi, 2001 ; Aithal & Karkou, 2023).
Depuis trente ans, la prise en charge de l’autisme a beaucoup évolué. On est passé de modèles strictement comportementaux – comme TEACCH ou ABA – centrés sur la correction des «comportements-problèmes», à des approches plus humaines, relationnelles et respectueuses du développement de l’enfant (Mesibov et al., 2005 ; Schweihofer, 2020). Si ces premières interventions ont offert un cadre structurant, elles ont aussi été critiquées pour leur manque d’attention aux besoins sensoriels, émotionnels et à l’expression subjective de l’enfant.
Aujourd’hui, les méthodes développementales comme le DIR/Floortime (Greenspan & Wieder, 2006), les modèles centrés sur l’attachement, ou encore le soutien à la régulation émotionnelle sont de plus en plus valorisés (Martin, 2021). Ces approches cherchent à s’adapter aux forces de chaque enfant, à bâtir une relation de confiance, et à soutenir l’autorégulation – étape essentielle pour tout développement social et affectif.

Dans ce contexte, les approches non verbales, sensorielles et artistiques trouvent pleinement leur place. Les enfants autistes, souvent très sensibles au visuel ou au geste, peuvent exprimer leur monde intérieur autrement que par le langage (Aithal & Karkou, 2023). Le jeu, l’art ou la musique deviennent alors des passerelles de communication précieuses.
Les neurosciences affectives rappellent aussi que la régulation émotionnelle est une compétence clé à soutenir. L’art-thérapie, par son cadre sécurisant et symbolique, s’intègre naturellement à ces approches intégratives actuelles (Schweihofer, 2020 ; Martin, 2021).
L’art-thérapie est pertinente auprès des enfants
Dans l’espace thérapeutique, les enfants TSA trouvent souvent un lieu où ils peuvent enfin être eux-mêmes. Là où l’école ou les contextes sociaux exigent certains comportements, l’art-thérapie offre une expression alternative, une présence ajustée, et un cadre sensoriel qui respecte leur rythme et leur perception du monde.
Une approche sensorielle, visuelle et non verbale
L’un des grands avantages de l’art-thérapie est qu’elle ne repose pas uniquement sur le langage parlé. Beaucoup d’enfants sur le spectre sont soit non-verbaux, soit mal à l’aise avec les codes implicites habituels du langage (Ferris, 2020). Par le geste, la couleur, la texture, la forme ou le jeu, l’enfant accède à une communication où il pourra se sentir plus à l’aise. Comme l’écrivent Evans et Dubowski (2001), le processus de création devient un langage en soi et le cadre est structurant, contenant et accessible.
Valorisation d’une pensée en images
Nombre d’enfants autistes ont une pensée visuo-spatiale développée – ils "pensent en images", comme l’a si bien décrit Temple Grandin. L’art-thérapie accueille cette compétence naturelle aisément. En dessinant, peignant, modelant, l’enfant peut extérioriser ses pensées compliquées sans avoir à les traduire verbalement. Ce processus crée un pont entre son monde intérieur et le monde extérieur, tout en le valorisant dans ce qu’il est : un être qui s’exprime autrement, sans déficience (Martin, 2021).

Un espace contenant et sécurisant
Le cadre de l’art-thérapie est prévisible, ritualisé, bienveillant. Ces aspects sont essentiels pour l’enfant autiste, souvent hyper-réactif aux changements ou à la surcharge sensorielle. Le matériel est proposé progressivement, le contact est modulé selon les besoins. Il n’est pas nécessaire de parler. Dans cet environnement stable, l’enfant peut se détendre, expérimenter, puis s’ouvrir à son rythme. L’art devient un tiers symbolique rassurant, qui facilite son expression, l’attachement et la construction du lien thérapeutique (Emery, 2004).
Régulation du système nerveux
Créer, c’est aussi réguler son système nerveux. Le geste créatif peut aider l’enfant à canaliser son agitation, à nommer symboliquement une émotion qui menace d’être trop intense. Ce processus favorise l’autorégulation, souvent difficile pour les enfants sur le spectre de l’autisme. Les recherches montrent que les séances d’art-thérapie peuvent faire baisser les niveaux d’anxiété chez cette population (Ferris, 2020).
Un soutien aux habiletés sociales
L’art devient un pont qui relie : une médiation entre le monde intérieur de l’enfant et la présence de l’autre, l’art-thérapeute. À travers le jeu symbolique, la création partagée ou l’observation mutuelle, l’enfant peut expérimenter une forme de réciprocité – base des compétences sociales (Evans & Dubowski, 2001). Ces micro-moments relationnels, même fugaces, sont de véritables apprentissages.
Un espace pour s’exprimer… et se découvrir
Enfin, l’art-thérapie offre un espace identitaire. L’enfant autiste y découvre souvent qu’il a du talent – une imagination, une manière originale de représenter le monde, un regard unique. Ce qui, ailleurs, peut être perçu comme un handicap devient ici une ressource et une fierté. Ce changement de regard, à la fois thérapeutique et sociétal, s’inscrit dans les approches actuelles en neurodiversité : reconnaître la différence sans vouloir "normaliser" à tout prix.

Études de cas d’enfant TSA en art-thérapie
Rien ne remplace le récit d’une séance d’art-thérapie. Voici trois exemples qui éclairent comment cette approche peut répondre aux besoins spécifiques des enfants sur le spectre de l’autisme.
Créer du lien à travers la co-création – Josh, 6 ans
Josh, diagnostiqué TSA avec un langage très limité, évitait tout contact visuel et ne tolérait pas la proximité physique. Lors des premières séances, il dessinait seul, toujours le même objet : une voiture bleue. L’art-thérapeute, respectant son espace, a commencé à dessiner sur une autre feuille dans le même style, en choisissant aussi une voiture bleue. Progressivement, Josh est venu observer, puis a accepté que leurs dessins soient posés côte à côte. Une co-création a émergé : une route reliant les deux voitures. Ce petit changement a permis une première interaction symbolique (Evans & Dubowski, 2001), amorçant le travail relationnel dans un cadre sécurisant, sans contact direct ni obligation verbale.
Contenir l’anxiété à travers la matière – Lucie, 10 ans
Lucie présentait des niveaux élevés d’anxiété, des crises fréquentes et une hypersensibilité sensorielle aigue. Lors des séances, elle refusait de toucher les matériaux salissants. L’art-thérapeute lui a proposé une feuille texturée et des pastels secs, pour qu’elle puisse dessiner sans contact direct avec la matière. Rapidement, Lucie a adopté un rituel de remplissage de mandalas, en jouant avec les couleurs pour calmer ses tensions internes. Ce processus répétitif et apaisant a renforcé les capacités de régulation émotionnelle de Lucie (Martin, 2021). En intégrant des préférences sensorielles dès le départ, l’art-thérapie est devenue un espace sécurisant, contenant pour elle.
Explorer l’attachement par l’image – Samir, 8 ans
Samir vivait en famille d’accueil après des ruptures familiales tragiques. Peu verbal et méfiant, il montrait des signes d’attachement désorganisé. L’art-thérapeute a proposé un travail autour des maisons imaginaires. Samir a dessiné une cabane perchée avec des doubles portes, qu’il a longuement refermées avec de la couleur noire.
Ce dessin a permis d’explorer, sans forcer, la métaphore du refuge. À travers les séances, les maisons sont devenues plus ouvertes, auxquelles se sont ajoutés d’autres éléments (fleurs, chemins, personnages) — une symbolisation progressive du lien (Durrani, 2014).

Pensée visuelle et créativité digitale
Dr Naiara Belart Garcia, chercheuse en Suisse, qui explore les liens entre autisme, pensée visuelle et outils numériques. Elle rappelle, dans la lignée des travaux de Temple Grandin, que de nombreuses personnes autistes ne pensent pas en mots mais en images. Leur esprit fonctionne comme un flux constant de films. Comprendre cette particulatité et la considérer comme une force change la manière d’accompagner les enfants qui en sont dotés : plutôt que de suivre la voie verbale, on propose des supports qui s’appuient sur ce mode de pensée en image.
Dans ce contexte, l’usage des arts numériques ouvre de nouvelles perspectives. La technologie devient un espace thérapeutique où l’enfant peut explorer ses intérêts, développer sa motricité, réguler ses émotions et même acquérir des compétences techniques. La conférence présentée par Belart Garcia durant le sommet d'art-thérapie 2022 montre que certains jeunes autistes, initialement repliés ont pu trouver de l'aide utile dans l'art-thérapie numérique. En utilisant la peinture sur application digitale, la création de films vidéo ou le design 3D, ils ont pu se diriger vers l’autonomie et la confiance en eux. Certains ont utilisé Photoshop ou Illustrator pour renforcer leur concentration, assouplir leur rigidité et élargir leur expressivité et leur capacité à être en relation.
Ce travail de pointe souligne que la technologie, intégrée dans le cadre thérapeutique, n’est pas en contradiction avec l’art-thérapie classique. Elle peut au contraire devenir un outil complémentaire, qui respecte la singularité neurodivergente et les intérêts de certains jeunes garçons pour la technologie. Comme le rappelle Belart Garcia, il s’agit moins de maîtriser un logiciel que de créer un cadre sécurisant et relationnel, où l’enfant peut être acteur de ses choix.
Nous avons une grille d'observation pour établir le profil sensoriel de l'enfant, gratuite, cliquez sur l'image:
Recommandations pour les art-thérapeutes travaillant avec les enfants autistes
-
Être patient
-
Donner des instructions claires et cohérentes
-
Encourager et soutenir
-
Voir le jeune comme étant unique
-
Être persévérant
-
Démontrer un réel intérêt pour le jeune
-
Découvrir leurs intérêts et suivre leur exemple
-
Reconnaître rapidement si l’intervention ne fonctionne pas et ajuster.
-
Mettre l’accent sur l’autonomie
-
Renforcer respectueusement leurs propres capacités
-
Distinguer quand enseigner et quand lâcher prise
-
Être ludique quand cela pourrait servir la situation
-
Garder l’espoir que les choses peuvent changer
-
Utiliser l’humour
-
Écouter activement
-
Exprimer de l’appréciation pour le jeune client et ses créations.
Conclusion
Loin des modèles uniformes, l’art-thérapie propose une réponse sensible, ajustée et profondément humaine aux besoins des enfants sur le spectre de l’autisme. Elle valorise leur pensée visuelle, respecte leur rythme sensoriel, et ouvre un espace de relation sans obligation de langage avec l’art-thérapeute.
En séance, l’enfant peut créer, se réguler, et parfois, nouer un lien. Il peut explorer son monde intérieur à travers l’image, dans un cadre sécurisant et contenant. Loin d’imposer des normes, l’art-thérapie révèle les forces, les imaginaires et les formes uniques d’expression de chaque enfant.
Aujourd'hui, les approches intégratives et non verbales sont de plus en plus reconnues dans les pratiques cliniques avec les enfants TSA. Pour qu'elles prennent pleinement leur place, il est essentiel d'initier d'anciens art-thérapeutes compétents à ces particularités, et de favoriser leur inclusion dans les équipes pluridisciplinaires.
En reconnaissant la valeur de l'art-thérapie, on honore aussi la richesse de la neurodiversité. Car au fond, chaque enfant mérite un espace pour être vu, entendu… et dessiné à sa façon.
*Toutes les images et photos illustrant cet article proviennent de la banque d'images de Canva.
Site web autisme Europe : https://www.autismeurope.org/fr/a-propos-dautism-europe/
Site web autisme France : https://www.autisme-france.fr/
Fédération québecoise de l’autisme : https://www.autisme.qc.ca/
Références:
Durrani, H. (2014). Facilitating attachment in children with autism through art therapy: A case study. Journal of Psychotherapy Integration, 24(2), 99.
Evans, K., & Dubowski, J. (2001). Art Therapy with Children on the Autistic Spectrum: Beyond Words. London: Jessica Kingsley Publishers, p. 63.
Grandin, T. (2009). Thinking in pictures. Bloomsbury Publishing.
Grandin, T. (2023). Visual thinking: The hidden gifts of people who think in pictures, patterns, and abstractions. Penguin.
Greenspan, S. I., & Wieder, S. (2006). Engaging autism: Using the floortime approach to help children relate, communicate, and think. Da Capo Lifelong Books.
Johnson, C. P., & Myers, S. M. (2007). Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders. Pediatrics, 120(5), 1183-1215.
Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G., & Veenstra-Vanderweele, J. (2018). Autism spectrum disorder. The lancet, 392(10146), 508-520.
Malchiodi, C. A. (Ed.). (2011). Handbook of art therapy. Guilford Press.
Mesibov, G. B., Shea, V., & Schopler, E. (2005). The TEACCH approach to autism spectrum disorders. Springer Science & Business Media.
Richardson, J. F. (2015). Art therapy on the autism spectrum: Engaging the mind, brain, and senses. The wiley handbook of art therapy, 306-316.
Richardson, J. F. (2022). Art as a language for autism: Building effective therapeutic relationships with children and adolescents. Routledge.
Stang, A. (2017). "Facilitating Attachment in Children with Autism through Art Therapy". In: Karkou, V., & Sanderson, P. (Eds.), Arts Therapies in the Treatment of Depression, Anxiety and Trauma. London: Routledge, p. 92-94.
Schweizer, C., Knorth, E. J., & Spreen, M. (2014). Art therapy with children with Autism Spectrum Disorders: A review of clinical case descriptions on ‘what works’. The Arts in Psychotherapy, 41(5), 577-593.
Livres généralistes sur le spectre de l’autisme
"Sais-tu pourquoi je saute?" (témoignage) par Naoki Higashida (2017)
"NeuroTribus, Autisme : plaidoyer pour la neurodiversité" par Steve Silberman (2020)
"Ma vie d'autiste" par Temple Grandin (2000)
"Dans le cerveau des autistes" par Temple Grandin et Richard Panek (2014)
"Uniquely Human A Different Way of Seeing Autism" by Barry M. Prizant (2015)
"Unmasking Autism" by Devon Price (2022)
"Is This Autism A Guide for Clinicians and Everyone Else" par Donna Henderson, Sarah Wayland et Jamell White (2023)
Livres en français (orientés psychanalyse) :
Art-thérapie et autisme, par Sophie Fardet (2015)
La cause de l'autiste, par Jean-Pierre Royol (2019)
Art-thérapie et autisme: du geste à la parole, écrit par Christine Lopez et
Michel Arnaud (2016)
Art-thérapie, autisme et dyslexie, par Maryse du Souchet-Robert (2014)
L'art de l'enfant, l'enfance de l'art: Art-thérapie, autisme, supervision, par Anastasia Nakov, Dominique Bablet et Dominique Desnot (2013)