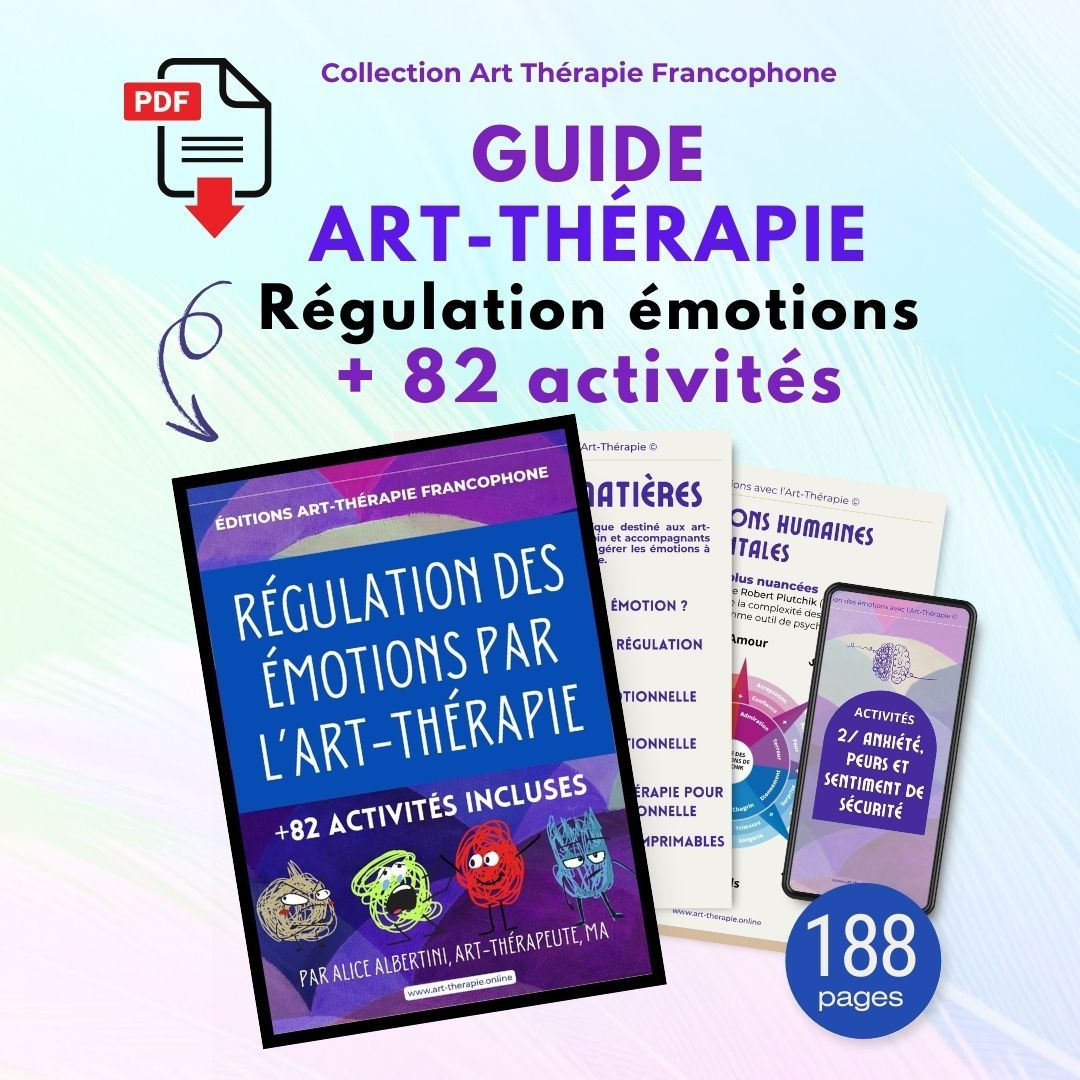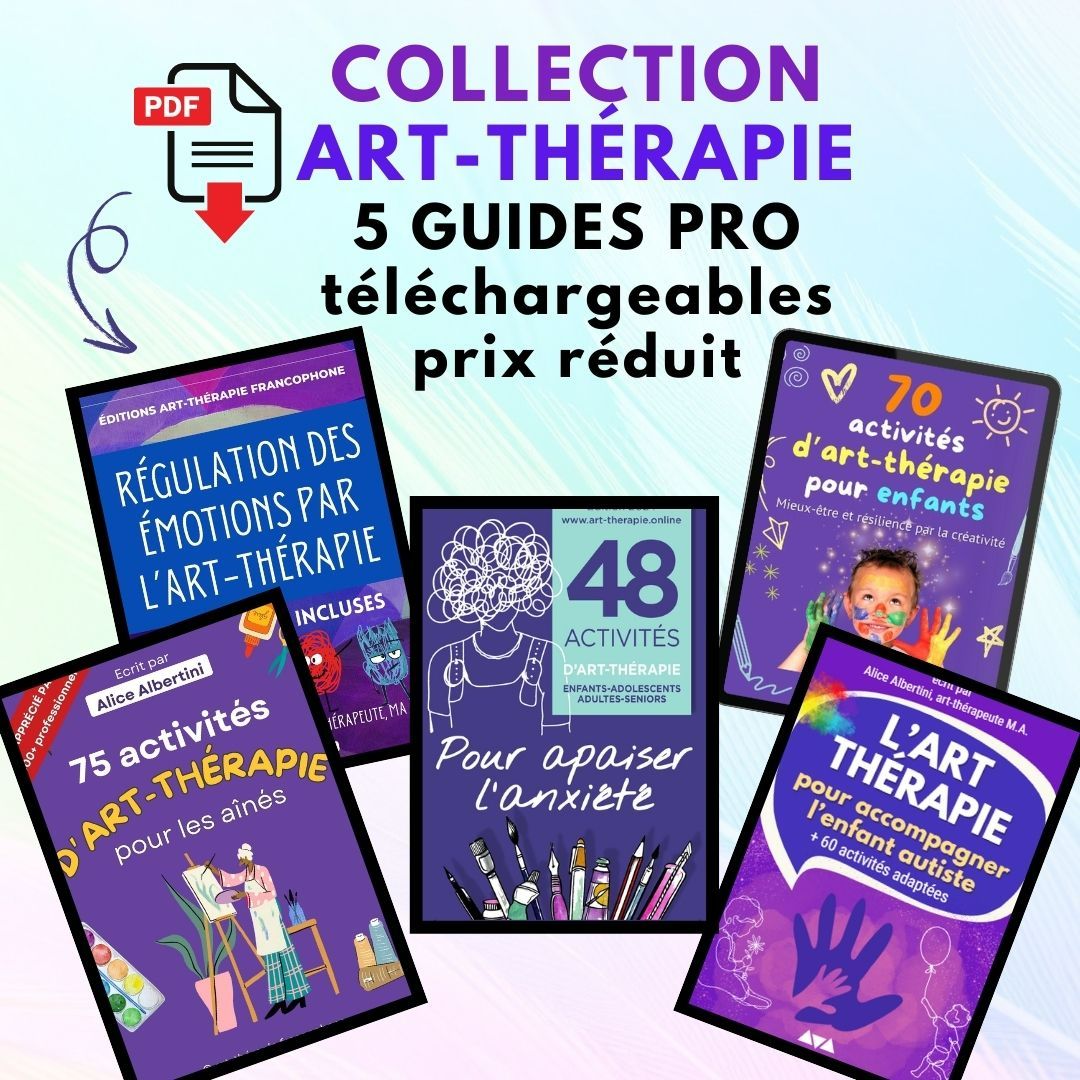Art-thérapie et psycho traumatisme : une revue intégrative

par Alice Albertini, MA, Art-thérapeute
Cet article aborde l'art-thérapie plastique.
Le traumatisme psychique ne se résume pas à un « mauvais souvenir ». Il laisse une empreinte durable dans le corps, la mémoire et le lien aux autres. Accidents, violences sexuelles, maltraitances, guerre, migration, pandémie : une part importante des personnes qui consultent en thérapie porte ces blessures persistantes. Quand les mots ne suffisent plus ou deviennent eux-mêmes menaçants, l’art-thérapie propose une voie distincte et créative : passer par le geste, la matière et l’image pour restaurer une continuité intérieure et une intégration de l’indicible.
Cet article propose une revue non exhaustive qui allie recherche, neurosciences et pratiques cliniques, basé sur des conférences qui ont été présentées au Sommet d’art-thérapie francophone 2025.
Dans cet article, nous abordons la définition du psychotraumatisme, avant de présenter pourquoi l’art-thérapie – plastique en particulier - est une solution pertinente dans ce domaine, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe.
L’objectif est d’offrir une introduction nuancée – et forcément partielle – de ce que l’art-thérapie peut apporter au traitement du traumatisme psychique aujourd’hui. Nous mettrons aussi l’emphase sur le contenu des conférences du Sommet d’art-thérapie 2025 qui offrent des apports précieux et pratiques sur le traumatisme.
Le coffret de ces conférences (disponible en ligne) est une ressource de qualité pour tous ceux et celles qui s’intéressent au sujet de l’art-thérapie et du psychotrauma.
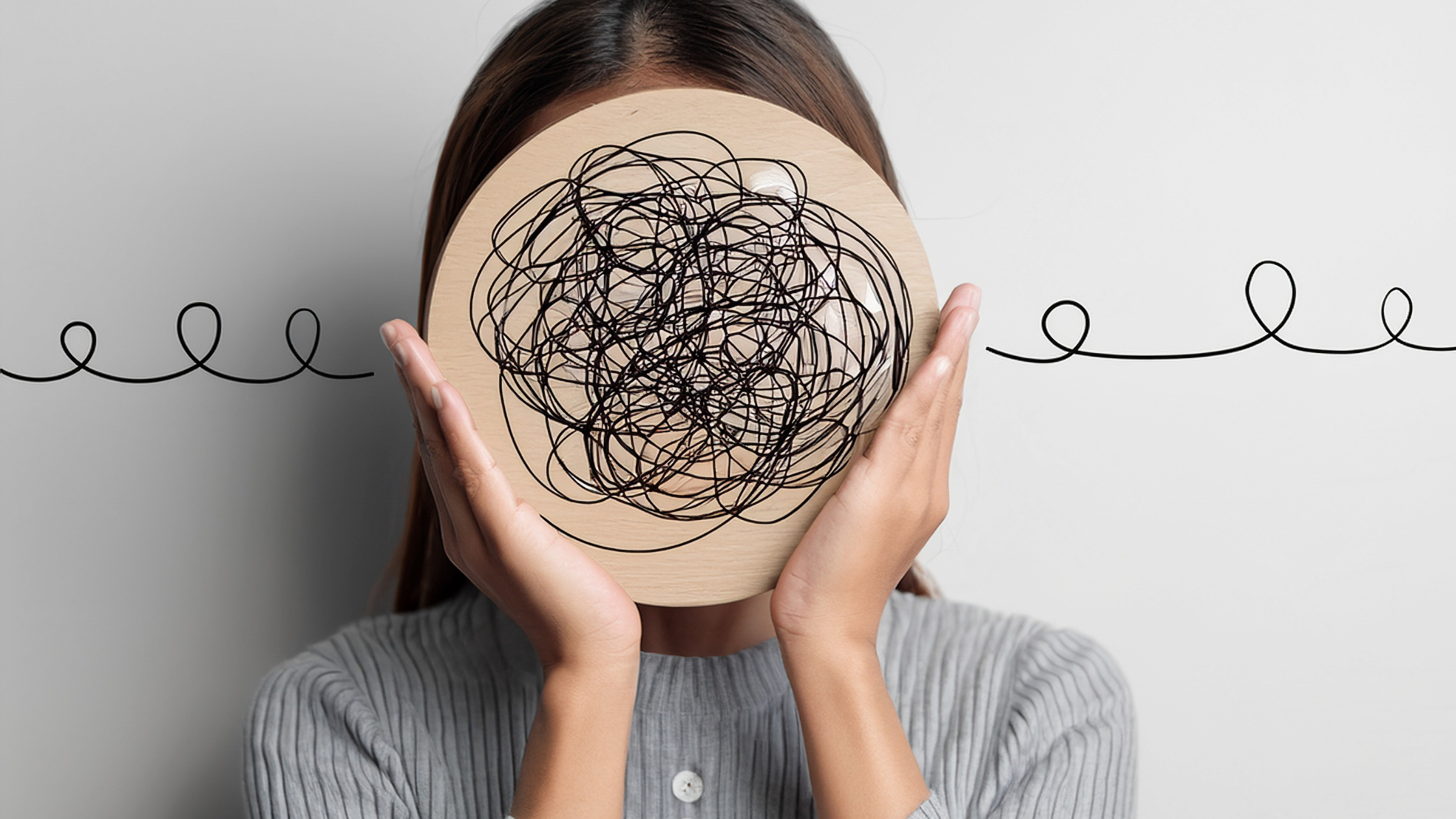
1) Comprendre le traumatisme aujourd’hui
Le traumatisme psychique désigne un choc dans l’intégrité psychique d’une personne, provoqué par un événement ou une série d’événements qui débordent sa capacité d’y faire face et de l’intégrer. Judith Herman (2015) distingue le trauma simple (lié à un événement ponctuel, comme un accident) du trauma complexe, issu d’expositions prolongées à la violence, à la négligence ou aux abus, en particulier durant l’enfance. Ces traumatismes développementaux attaquent l’image de soi, la confiance relationnelle et la régulation émotionnelle. La personne traumatisée ne parvient pas à vivre sa vie, car le traumatisme la "garde" en otage.
Le psychiatre Bessel van der Kolk (2018) rappelle que dans l’expérience du traumatisme « le corps n’oublie rien » : les souvenirs ne s’organisent pas comme une histoire passée, mais comme un état d’alerte présent, toujours prêts à se réactiver dans le système nerveux. Flashbacks, hypervigilance, cauchemars, anesthésie émotionnelle et troubles somatiques témoignent de cette mémoire implicite qui ne trouve pas d'issue. Peter Levine (2024), auteur du livre « Réveiller le tigre », décrit cette réalité comme une « énergie gelée » dans le corps, prise dans les réponses au stress : figement, fuite, lutte (fight/fight/freeze).
La théorie polyvagale de Stephen Porges (2021), diffusée cliniquement par Deb Dana (2023), aide à comprendre ces différents états de réponse au danger. Le système nerveux autonome oscille entre plusieurs modes : sécurité et lien (vagal ventral), mobilisation (sympathique), shutdown (vagal dorsal). En perception de menace (un bruit fort, une odeur de brûlé), beaucoup de personnes se retrouvent figées ou coupées d’elles-mêmes, même s’il n’y a pas de réel danger. Mais leur cerveau a perdu la capacité de le distinguer. Comme le montre Carmen Oprea dans sa conférence du sommet, l’objectif du soin n’est pas de parler de ce qui s’est passé, mais de retrouver une perception de sécurité et la capacité à sentir que, ici et maintenant, le corps peut se détendre.
Au Sommet d’art-thérapie 2025, Mia Hébert et Annie Boyer-Labrouche ont rappelé comment l’art-thérapie permet de travailler à la fois la blessure intime et le silence social qui l’entoure, en faisant de la création un lieu de dignité plutôt que de pathologisation.
Pour voir ces conférences, le coffret d’art-thérapie 2025 est disponible ici.

2) Pourquoi l’art-thérapie est pertinente face au trauma
L’art-thérapie vient précisément là où la parole seule trouve ses limites. Après un choc, de nombreuses personnes ne peuvent pas "raconter" l’indicible. Soit les mots manquent, soit ils déclenchent une reviviscence trop intense. Comme on l'a vu précédemment, le choc est imprimé dans un corps, désormais sous pression constante. L’art-thérapie permet de ne pas avoir à revivre ce récit traumatique : elle propose un espace sécurisant pour tracer, modeler, coller, déchirer, recomposer, grâce au processus créatif et les matériaux. Le médium artistique devient une langue tierce, qui autorise la distance, la métaphore et l’ambiguïté. L'art-thérapeute étant gardien-ne de cet espace de permission et de contenance.
Depuis les années 1970, des études cliniques en art-thérapie montrent que, chez les enfants exposés à la guerre, aux deuils violents ou aux abus, les séances diminuent l’angoisse, les cauchemars et certains troubles comportementaux. À partir des années 2000, des études contrôlées viennent approfondir les connaissances: Lyshak-Stelzer & al. (2007) montrent qu’un groupe d’adolescents présentant un SSPT, en créant un « livre de vie » illustré voient leurs symptômes diminuer.
Une revue systématique récente de Morison et al. (2022) confirme que les thérapies créatives (arts visuels, musique, dramathérapie, danse) améliorent les symptômes de STPT (syndrôme de stress post traumatique) et la qualité de vie d'enfants et d'adolescent·es exposés à des événements traumatiques.
Cathy Malchiodi (2020) souligne l'importance des art-thérapies « informées par le trauma » : ces approches combinent régulation émotionnelle, extériorisation graduée du vécu, aspect sensorimoteur, rythme et réparation du lien. L’australienne Cornelia Elbrecht, avec le Clay Field (2019) et le guided drawing (2012), montre comment l'aspect sensorimoteur de la peinture ou de l'argile remettent le corps dans un espace de repos, permettant une réparation implicite. Elle a donné une extraordinaire conférence sur le dessin bilatéral guidé. Pour voir sa conférence traduite en français, cliquez ici.
Avec ces différentes perspective, l’art-thérapie dépasse de très loin l'idée du "coloriage qui calme". C'est est une modalité de soin, basée sur la science, qui s’inscrit dans le champ du traitement du psychotraumatisme, à condition d’être pratiquée dans un cadre clinique solide par des art-thérapeutes qui ont la formation nécessaire.
3) Neurosciences, corps et création : ce que la science dit
Les neurosciences ont étoffé notre compréhension du traumatisme et enrichi le rôle de l’art-thérapie. Les chercheurs Hass-Cohen et Findlay (2015), Juliet King (2016) ou encore Gantt et Tinnin (2009) montrent que l’acte créatif mobilise simultanément plusieurs circuits neuronaux : sensorimoteur (geste, posture, contact), émotionnel (système limbique) et cognitif (mise en forme, choix, symbolisation). Le fait de créer en séance constitue un « pont » entre des zones du cerveau qui, après un trauma, ont tendance à fonctionner séparément.
Même après des événements difficiles, le cerveau conserve une capacité de changement. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ce potentiel se déploie toutefois dans un cadre sécuritaire et répétitif, où la personne bénéficie de la relation thérapeutique, la permission de jouer et la diversité des matériaux. L’art-thérapie offre précisément ce contexte : temps dédié, règles claires, gestes répétés, liberté d’exploration dans des limites contenantes.
La théorie polyvagale (Porges,2021; Dana, 2023) vient compléter ces connaissances. Comme le montre Carmen Oprea, le travail sur les rythmes, les textures, la respiration dans un cadre confidentiel, permet d’envoyer au système nerveux des signaux d'apaisement. La ligne sur le papier, la couleur peinte doucement, la texture de l’argile sous les doigts, deviennent des micro-expériences où la personne réapprend à se détendre sans perception de danger.
Les approches sensorimotrices de Cornelia Elbrecht illustrent une logique « bottom-up » : partir du ressenti corporel en premier plutôt que du récit. À partir d’une tension (« boule dans l’estomac », gorge serrée, fatigue lourde), la personne est invitée à dessiner avec les deux mains, de manière rythmique et bilatérale sur un grand papier. Le geste se transforme peu à peu : d’un mouvement tendu et fragmenté, il devient plus fluide, parfois enveloppant. Ce passage du ressenti brut à une action symbolique régulatrice permet de dégeler progressivement l’énergie figée dans le système nerveux. Vous pouvez visionner sa conférence passionnante en cliquant ici.
Johanne Hamel, avec l’art-thérapie somatique, articule le lien avec l'image interne, la sensation corporelle et symbolisation. Pour elle, les images produites ne sont pas seulement des métaphores visuelles : ce sont des expériences également sensorielles. Travailler sur ces images – les décrire, les modifier, les relier au ressenti présent – contribue à reconstruire un « moi incarné et unifié » là où le trauma avait fracturé le lien entre psyché et corps.
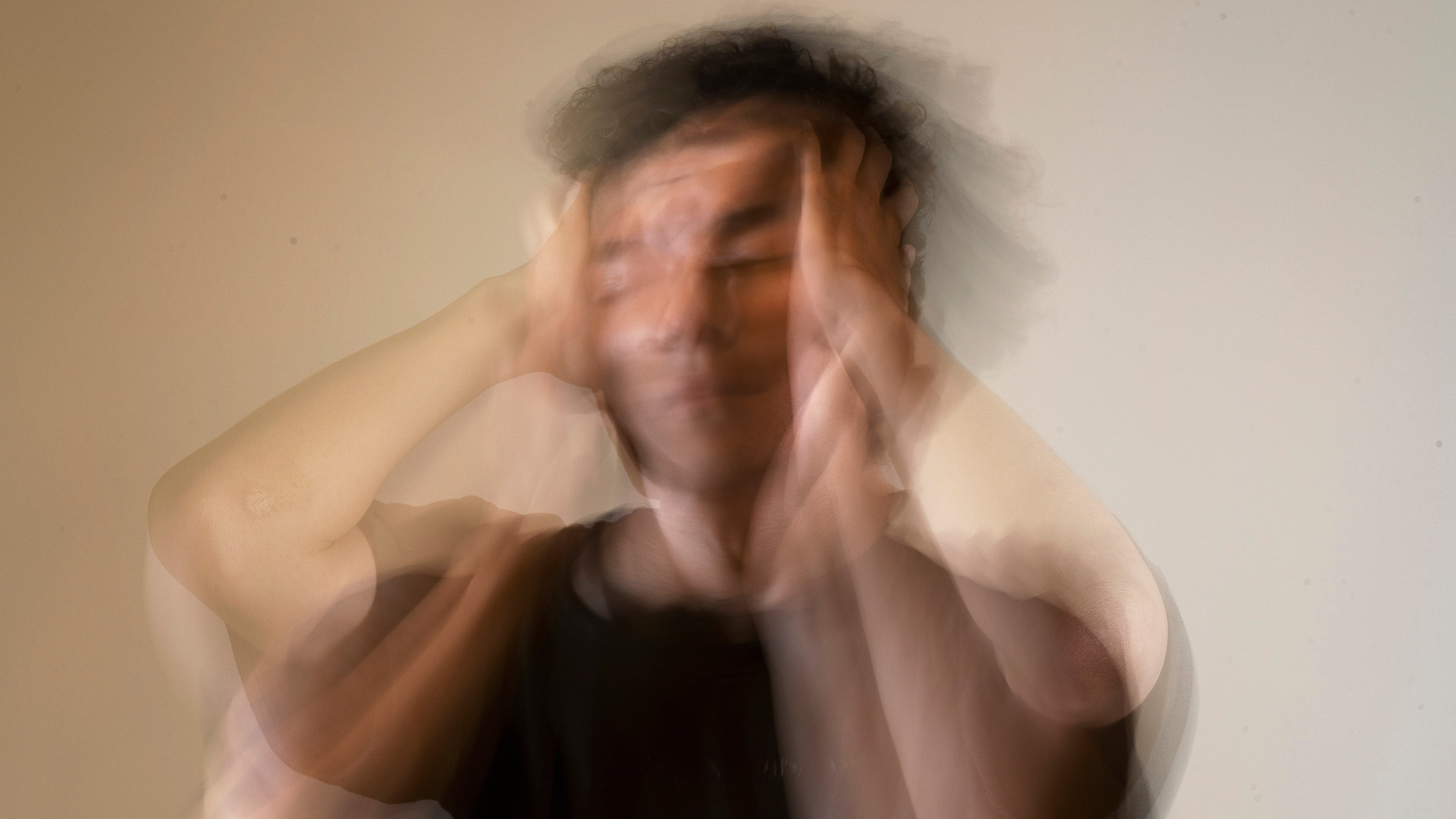
4) Perspectives cliniques francophones
En France, une partie importante de la clinique du trauma est marquée par l’héritage psychanalytique. Jean-Pierre Klein rappelle que l’inconscient ne se réduit pas à un réservoir de symptômes : il est aussi une source de créativité et d’innovation. L’art-thérapie, dans cette lignée, ne cherche pas à « interpréter » chaque image, mais à accompagner un processus de transformation d’une œuvre à l’autre.
Alain Dikann décrit le traumatisme comme un effondrement de sens qui nécessite un travail de reprise en différentes étapes progresives : stabilisation, expression de la scène traumatique, élaboration de sens, puis réinscription dans le quotidien. À chaque phase, l’art-thérapie apporte quelque chose de spécifique : travail sur la sensorialité et les limites, représentation de scènes indicibles, jeux d’échelle et de point de vue, création de figures ressources.
Annie Boyer-Labrouche insiste sur la valeur du cadre : temps, espace, règles et présence du thérapeute forment une enveloppe que Didier Anzieu appelle le « Moi-peau » symbolique. Le médium artistique devient un « troisième partenaire » entre patient et thérapeute, un espace transitionnel, où la personne peut déposer sa terreur, sa honte, sa colère, sans être entièrement submergée.
Du côté québécois, les approches présentées au Sommet 2025 mettent l’accent sur le corps, la théorie polyvagale et la dimension sociale du trauma. Carmen Oprea travaille avec des personnes aux traumatismes complexes, en particulier au sein des Premières Nations. Marie-pier Malo, avec le projet l’Arbre aux galets (deuil durant la pandémie), propose un dispositif d’art-thérapie sociale où chacun peint un galet en lien avec ses deuils, avant de le déposer dans une sculpture collective, un rituel de mémoire et de réparation partagée.
Mia Hébert, quant à elle, accompagne les survivant·es d’agressions sexuelles. Elle insiste sur le consentement, le respect du rythme, et l’usage de métaphores visuelles (portes, seuils, paysages) pour permettre la reconstruction identitaire sans exposition brutale.
Ces contributions francophones – françaises et québécoises – témoignent d’une art-thérapie adaptée au traumatisme à la fois ancrée dans la recherche et attentive aux contextes sociopolitiques spécifiques (violences sexuelles, colonialisme, pandémie, précarité). Le Coffret 2025 permet de les voir à l’œuvre, dans des dispositifs concrets, au-delà de ce que peut décrire un article. Cliquez ici pour en savoir plus.

5) Les défis de l’art-thérapeute face au traumatisme
Accompagner une personne traumatisée en art-thérapie est un travail exigeant, qui demande une excellente formation. La première responsabilité de l'art-thérapeute est la contenance : offrir un cadre solide, répétitif pour que des contenus bruts puissent émerger sans déborder. Cela implique un lieu structuré, une temporalité stable, des règles claires, mais aussi la capacité de l’art-thérapeute à rester présent-e face à des productions parfois intenses.
Vient ensuite la régulation émotionnelle. La création peut faire surgir l’affect plus vite que la parole. Un simple trait, une couleur, une texture peuvent déclencher un flashback ou une dissociation. L’art-thérapeute doit savoir repérer les signes de débordement (regard vide, agitation, raidissement) et ajuster le processus : ralentir, changer de médium, proposer un dessin ressource, revenir au présent, travailler sur l’ancrage. L’objectif n’est pas « d’aller au plus vite » à tout prix, mais de rester dans la fenêtre de tolérance, cette zone ou la personne est présente à elle-même.
Les questions de transfert et de contre-transfert sont également importantes. Les personnes traumatisées testent souvent la fiabilité du cadre. En retour, l’art-thérapeute peut être touché-e, remué-e, parfois épuisé-e par l'intensité du vécu traumatique. D’où la nécessité d’une supervision régulière, d’un travail sur soi et de self-care. Sans cela, le trauma vicariant risque d’affecter l’art-thérapeute, qui ne sera plus en mesure d’aider son ou sa client-e.
Plusieurs conférences du Coffret 2025 abordent le thème du traumatisme et montrent comment travailler avec les personnes de manière professionnelle et éthique.

Prolonger la réflexion avec le Coffret d’art-thérapie 2025
L'accompagnement en art-thérapie de personnes ayant vécu un traumatisme, pointe en direction qui élargit la réparation au-delà du mode cognitif ou verbal seulement. Le psychotrauma touche la mémoire, le corps, le système nerveux et le lien. Il fragilise le sentiment d'être soi, abîme la capacité à vivre sa vie en paix et garde la personne en otage dans le passé. Dans un cadre clinique structuré, l’art-thérapie permet de rouvrir des passages de vitalité là où tout semblait figé : par le geste, la matière, les symboles, et surtout par la relation thérapeutique avec l’art-thérapeute.
Les recherches et la littérature abordées (rapidement) dans cet article le montrent : l’art-thérapie soutient la personne dans la régulation émotionnelle, la symbolisation et contribue à restaurer sa capacité à percevoir le présent de manière plus ajustée. Il existe plusieurs approches d'art-thérapie pour accompagner les personnes ayant vécu un traumatisme, mais ce qui est certain, c'est que c'est que la création offre des possibilités nombreuses pour le rétablissement.
Pour en savoir plus, le Coffret d’art-thérapie 2025 contient plusieurs conférences de qualité sur le traumatisme:
- Pour mieux soigner le traumatisme et l’état destress post- traumatique par Alain Dikann
- L’arbre au galets: Accompagner les traumas collectifs et le deuil par Marie-Pier Malo
- Trauma & dessin bilatéral(vostfr) par Cornelia Elbrech pour voir sa conférence gratuitement, clique ici.
- Journal créatif et approche centrée solutions par Emily Hawkes & Cécile Bertrand
- La valeur thérapeutique de l'art par Annie Boyer Labrouche
- L'art-thérapie, trauma et théorie polyvagale par Carmen Oprea
- L'art-thérapie et le trauma par Dominique Sens
Pour approfondir sa clinique, ces conférences exclusives sont maintenant disponibles dans le coffret d'art-thérapie 2025 à 50% de rabais.
Entrez le coupon FLASHNOV50 pour obtenir 50% de réduction sur le prix régulier. Offre valide jusqu'au 23 novembre minuit.
Références
- Dana, D. (2018). The Polyvagal Theory in Therapy. Norton.
- Dana, D. (2023). S’ancrer dans la sécurité : Guide pratique de la théorie polyvagale. In S’ancrer dans la sécurité. EDP sciences.
- Elbrecht, C. (2012). Trauma healing at the clay field: A sensorimotor art therapy approach. Jessica Kingsley Publishers.
- Elbrecht, C. (2019). Healing trauma with guided drawing: A sensorimotor art therapy approach to bilateral body mapping. North Atlantic Books.
- Gantt, L., & Tinnin, L. W. (2009). Support for a neurobiological view of trauma with implications for art therapy. The Arts in Psychotherapy, 36(3), 148-153.
- Hamel, J. (2021). Somatic Art Therapy. In Somatic Art Thérapie (pp. 7-9). Routledge.
- Herman, J. L. (2015). Trauma and recovery: The aftermath of violence - from domestic abuse to political terror. Hachette uK.
- Hass-Cohen, N., & Findlay, J. C. (2015). Art therapy and the neuroscience of relationships, creativity, and résilience: Skills and practices. WW Norton & Company.
- King, J. (2016). Art Thérapie, Trauma and Neuroscience. Routledge.
- Klein, J. P. (2014). Initiation à l'art-thérapie - Découvrez-vous artiste de votre vie. Marabout.
- Lyshak-Stelzer, F., Singer, P., St. John, P., & Chemtob, C. M. (2007). Art therapy for adolescents with posttraumatic stress disorder symptoms: A pilot study. Art Therapy, 24(4), 163-169.
- Levine, P. A., & Schittecatte, M. (2019). Réveiller le tigre : guérir le traumatisme. InterÉditions.
- Levine, P. A. (2024). Guérir par-delà les mots : comment le corps dissipe le traumatisme et restaure le bien-être. Interéditions.
- Malchiodi, C. A. (2020). Trauma and expressive arts therapy: Brain, body, and imagination in the healing process. The Guilford Press.
- Morison, L., Simonds, L., & Stewart, S.-J. F. (2022). Effectiveness of creative arts-based interventions for treating children and adolescents exposed to traumatic events: A systematic review of the quantitative evidence and meta-analysis. Arts & Health: An International Journal for Research, Policy and Practice, 14(3), 237–262.
- Porges, S. W. (2021). La théorie polyvagale. EDP sciences.
- Van der Kolk, B. (2018). Le corps n’oublie rien : le cerveau, l’esprit et le corps dans la guérison du traumatisme. Albin Michel.