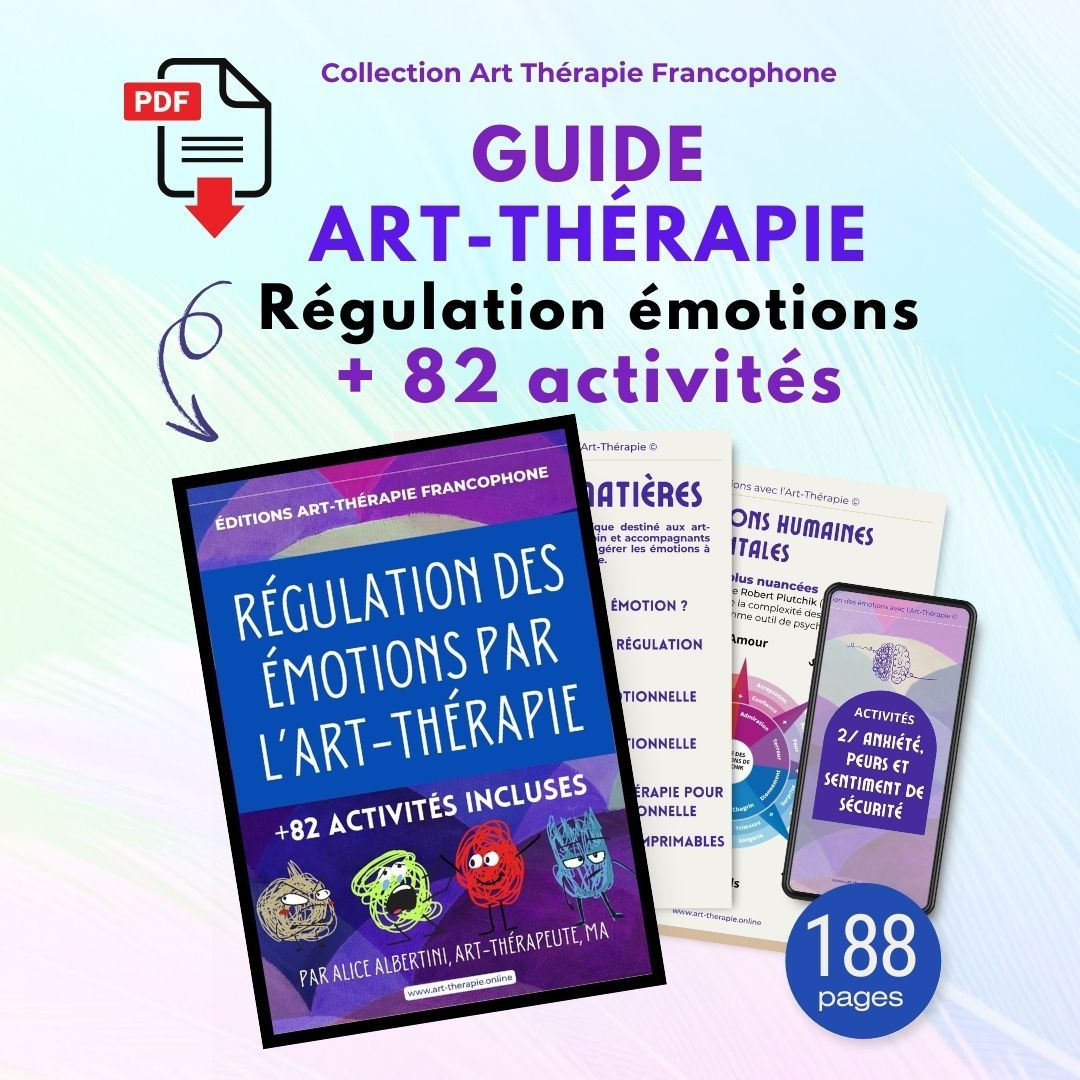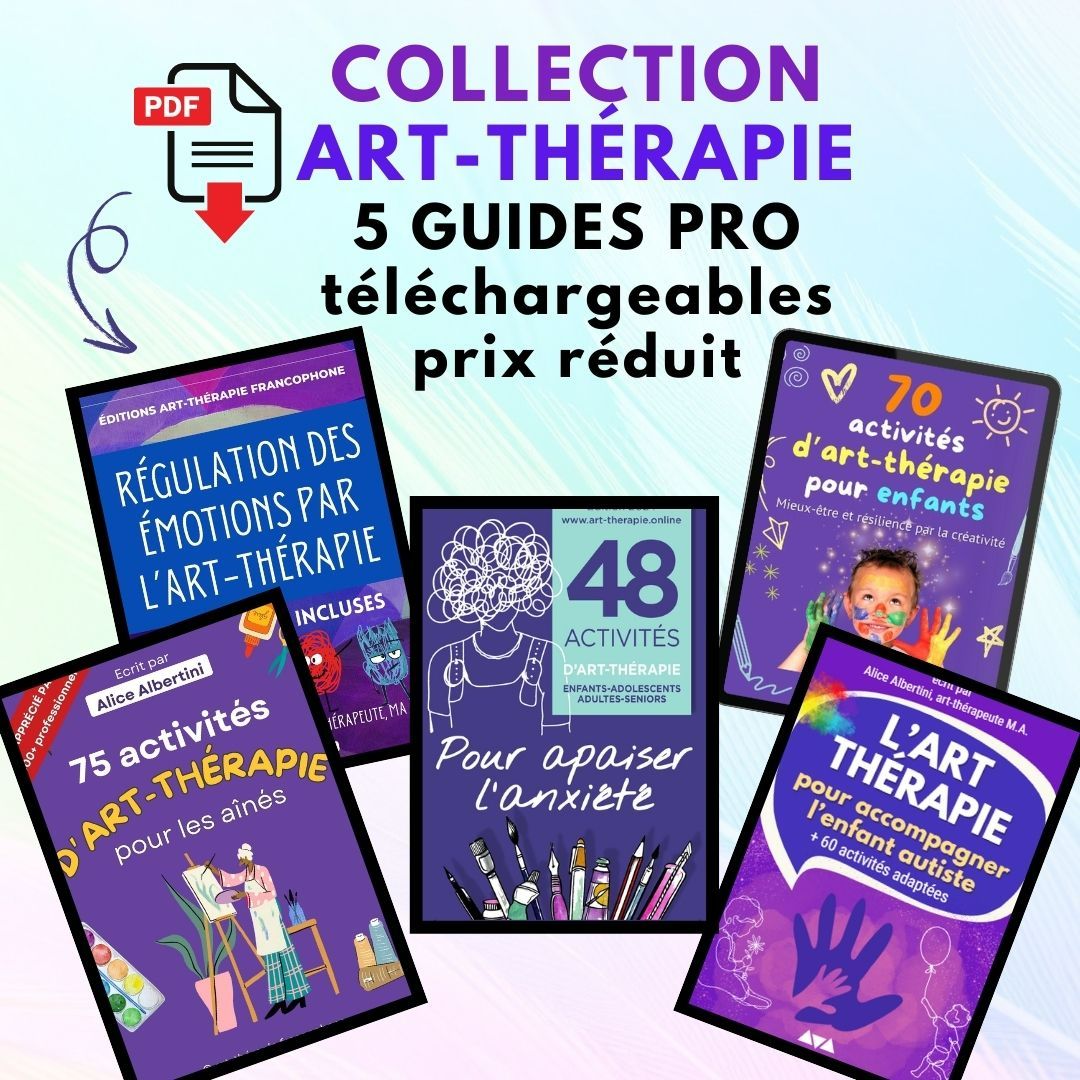Archétypes en art-thérapie : entre imaginaire et matière

Écrit par Alice Albertini, art-thérapeute MA (art-thérapie modalité plastique)
Introduction
Quand une personne franchit la porte du studio d’art-thérapie, elle ne sait jamais vraiment ce qui l’attend. Elle arrive avec un poids, une question, ou simplement le besoin d’une direction nouvelle. En présence de l’art-thérapeute, elle prend un pinceau, un morceau d’argile, quelques papiers colorés… et se met à créer. Peu à peu, une forme apparaît : silhouette, visage, figure émergeant d’un lieu profond et mystérieux.
C’est ce que Carl Gustav Jung appelait un archétype (du grec archetypos, « première empreinte ») : une image universelle enracinée dans l’inconscient collectif. Ces figures apparaissent dans les rêves, les mythes, les contes… et dans l’art. Elles ne sont pas des rôles à jouer, mais des modèles fondamentaux qui façonnent notre expérience intérieure.
L’art-thérapie, par sa dimension matérielle, devient un terrain privilégié pour explorer ces images avec ses mains et son imaginaire. Peindre une nature nourricière, modeler le bouclier d’un héros, illustrer les étapes d’un voyage initiatique : chacune de ces créations révèle des dynamiques intérieures, des tensions, mais aussi des ressources insoupçonnées.
Dans cet article, nous verrons comment les archétypes prennent sens dans la pratique de l’art-thérapie et comment les art-thérapeutes s’en servent pour accompagner la transformation psychique de leurs clients.

Qu’est-ce qu’un archétype?
Un archétype est une structure universelle issue de l’inconscient collectif, qui se manifeste dans les mythes, les contes, les rêves et bien entendu dans les créations artistiques. Même s’il peut avoir l’air abstrait, il prend forme à travers des images et figures reconnaissables : la mère, le héros, la sorcière, le roi, l’ermite…
Au 20e siècle, Carl Gustav Jung a mis en lumière leur rôle essentiel dans le développement psychique. Il écrit : « L'archétype est un contenu inconscient qui est modifié par le fait de devenir conscient et d'être perçu, et il prend la couleur de la conscience individuelle dans laquelle il apparaît. Il n'est donc pas seulement une forme statique, mais aussi une force dynamique » (The Archetypes and the Collective Unconscious, §155). Les archétypes sont ainsi des forces vivantes qui influencent nos expériences et orientent nos choix de vie.
Ils révèlent les tensions et polarités de la psyché, se métamorphosant d’une image à l’autre, d’une création à une autre. Leur vitalité en fait de puissants miroirs. Nous pouvons tour à tour nous reconnaître dans l’artiste, le guerrier, le sage ou la déesse – autant de facettes de l’humain en quête de sens et de transformation.
En art-thérapie, les archétypes surgissent spontanément dans les créations. Une adolescente dessine une grande figure féminine protégeant des enfants : sans le nommer, elle convoque l’archétype de la Mère. Cette image ouvre un dialogue : parle-t-elle de sa mère réelle, d’un besoin de protection, ou d’une force intérieure qui cherche à émerger? Ici, le dessin devient une passerelle entre son vécu personnel et une empreinte universelle.
Les archétypes ne sont pas de simples « modèles » à imiter. Ils appartiennent à un langage animé, qui prend racine dans l’inconscient et s’exprime par symboles. C’est pourquoi l’art – peinture, collage, sculpture, théâtre – est un terrain privilégié pour les rencontrer. Loin de garder les images prises dans des catégories, l’art-thérapie propose d’entrer en dialogue avec elles, de les laisser se transformer et par le fait même nous transformer.
Comme l’écrit Nora Swan-Foster dans Jungian Art Therapy, l’art-thérapie permet de « dialoguer avec les archétypes à travers la matière, le papier, la couleur, la ligne, le masque… », ouvrant la voie au processus d’individuation décrit par Jung : un chemin de maturité vers l’unité intérieure. Les archétypes cessent alors d’être des concepts lointains pour devenir des alliés créatifs, guidant le processus thérapeutique.
Carl Jung et les archétypes
Carl Gustav Jung (1875-1961), fondateur de la psychologie des profondeurs, a placé les archétypes à une place importante, dans sa cartographie de la psyché. Au-delà de l’inconscient individuel, il identifie un inconscient collectif, partagé par toute l’humanité, où résident ces formes « modèles » : les archétypes.
Jung s’appuie sur de multiples sources – traditions religieuses, récits mythologiques, écrits alchimiques, rêves de ses patients – pour montrer que ces archétypes apparaissent même chez tout type de personnes, même ceux qui n’ont pas de traditions dans leur éducation.
Rencontrer un archétype, selon lui, n’est pas une simple observation: c’est une expérience transformative. Dans un rêve marquant ou à travers une création artistique, il peut mettre sur la voie du processus d’individuation, c’est-à-dire d’intégration de contenus inconscients qui élargissent l’identité de la personne.
Les archétypes ne sont jamais uniques : ils contiennent une polarité. La Mère peut nourrir ou dévorer, le Héros incarner le courage ou l’arrogance. Approcher ces forces, c’est donc travailler avec leurs lumières et leurs ombres, en acceptant les tensions qu’elles suscitent pour les intégrer à la conscience. Ainsi, la personne sera en mesure d’intégrer à la fois l’enfant et l’adulte, le féminin et le masculin, l’ombre et la lumière dans sa conscience.

Exemples d’archétypes en psychothérapie :
- La Mère : sécurité, soin, fécondité, mais aussi dépendance. La grande mère, Gaia est cet archétype universel plus grand que l’humain.
- Le Héros : celui qui affronte l’épreuve avec courage et revient transformé.
- L’Ombre : les aspects refoulés, niés ou craints, mais aussi des forces créatrices (appelées aussi golden shadow). Elle surgit sous forme de monstres ou figures inquiétantes. La représenter, c’est commencer à l’intégrer à la conscience. L’ombre est souvent projetée sur les personnes externes qu’on déteste. C’est un archétype délicat à aborder seul-e.
- L’Anima et l’Animus : figures du féminin intérieur chez l’homme et du masculin intérieur chez la femme. Ils incarnent l’altérité sexuelle et sont souvent projetés sur les partenaires recherchés ou les conjoints externes.
- Le Vieux Sage : guide intérieur, source de sagesse dans les moments de crise. Exemple : Merlin ou maître Yoda.
- Le Trickster : fripon, clown ou perturbateur. Il représente les forces de l’absurde, du chaos, et bouscule l’ordre établi. Exemple : le joker dans Batman.
Chaque archétype agit comme un miroir. Lorsqu’une cliente façonne une poupée pour représenter son enfant intérieure, elle met en forme une dynamique d’abord inconsciente. Cette création n’est pas seulement personnelle : elle résonne avec une histoire collective vécu par bien des humains avant elle.
C’est là que la pensée de Jung et l’art-thérapie se rejoignent : les images produites en atelier ne sont pas que des expressions d’individus. Elles se relient à un langage universel, offrant a cette cliente une compréhension élargie d’elle-même et une cartographie lui montrant le chemin d’une résolution.

Vues contemporaines sur les archétypes
À la suite de Carl Jung, plusieurs penseurs ont poursuivi la réflexion sur les archétypes afin de les rendre accessibles et utiles à la vie quotidienne. Leurs apports offrent des perspectives précieuses pour comprendre nos expériences intimes d’une manière actuelle.
L’analyste jungien Robert Johnson (1921-2018) a su vulgariser ces notions pour un large public à travers ses ouvrages. He (1974) explore la quête masculine à travers l’archétype du Graal, She (1976) se penche sur les figures féminines, et Owning Your Own Shadow (1991) sur l’intégration de l’Ombre. Il y décrit les polarités masculines et féminines comme un chemin vers l’équilibre intérieur. Pour Johnson, les archétypes ne sont pas des récits figés mais des repères inspirants pour traverser les étapes de la vie.
Jean Shinoda Bolen, psychiatre et analyste jungienne américaine d’origine japonaise, a marqué la psychologie féministe avec son regard sur les archétypes féminins. Dans Les déesses en chaque femme (1984), elle montre comment les déesses grecques (Artémis, Aphrodite, Athéna, Hestia, etc.) incarnent des dynamiques psychologiques présentes chez les femmes d’aujourd’hui. Ce travail a ouvert de nouvelles voies pour reconnaître la diversité des forces féminines intérieures et a inspiré de nombreux ouvrages sur le sujet.
Anthony Stevens (1933-2023), psychiatre et analyste britannique, a quant à lui rapproché la théorie jungienne des sciences contemporaines, notamment l’éthologie et la biologie évolutive. Dans Archetype: A Natural History of the Self (1982), il décrit les archétypes comme des « programmes innés » inscrits dans notre héritage biologique. Selon lui, ils fonctionnent comme des structures psychobiologiques universelles, comparables aux instincts, guidant nos réactions face aux grandes étapes de la vie : naissance, maternité, attachement, quête amoureuse, deuil. Cette approche naturaliste explique pourquoi les mêmes figures apparaissent dans des mythes issus de cultures éloignées.
Réunies, ces perspectives montrent combien les archétypes demeurent des instruments vivants pour l’être humain. En art-thérapie, cette diversité théorique est précieuse : elle permet d’accueillir les images créées par les clients non seulement comme des symboles psychiques, mais aussi comme des échos de leur histoire corporelle, de leur identité et de leur chemin vers la guérison.

Utilisation des archétypes en art-thérapie
Après avoir exploré la vision jungienne et les approches contemporaines, une question s’impose : comment ces images universelles prennent-elles vie dans un atelier d’art-thérapie?
C’est ici que la posture des art-thérapeutes professionnels devient nécessaire. Les arts visuels, mais aussi la dramathérapie, l’écriture ou la musique, offrent un langage sensible pour donner forme à ces figures de l’inconscient, le tout accompagné par la présence d’un-e art-thérapeute. Les archétypes cessent alors d’être de simples concepts : ils deviennent des présences dynamiques, que l’on peut peindre, modeler, incarner ou confronter.
Plusieurs chercheur·es et praticien·nes ont développé des méthodes pour articuler archétypes et processus créatif, constituant un véritable pont entre la théorie jungienne et la pratique clinique actuelle.
Dans Jungian Art Therapy (2018), Nora Swan-Foster montre comment les images archétypales surgissent en séance d’art-thérapie : mandalas, animaux, figures mythologiques. Ces formes, issues de l’inconscient, traduisent les conflits et mouvements psychiques du moment. Swan-Foster insiste : il ne s’agit pas d’interpréter, mais d’accompagner le dialogue avec le symbole, toujours changeant, afin d’ouvrir le chemin de l’individuation.
Yehudit Silverman, professeure à Concordia et créatrice de The Story Within (2020), a développé une approche qui combine le pouvoir des contes de fées et de la dramathérapie. Les récits traditionnels, riches en archétypes (sorcière, héros, enfant abandonné…), deviennent des miroirs pour les histoires intérieures des participants. En rejouant ces récits, ils transforment leur vécu. Ainsi, une cliente revisitant La Belle au bois dormant a pu reconnecter avec sa vitalité créatrice longtemps « endormie ».
Au Québec, Johanne Hamel a contribué à lier art-thérapie, rêves et le corps. Inspirée par Jung et Shaun McNiff, elle souligne que les archétypes de la nature – arbre, maison, océan – ne sont pas seulement visuels, mais corporels et émotionnels. Cette perspective rend leur usage précieux, notamment dans le travail du trauma : l’archétype crée une distance qui rend l’exploration plus douce et sécurisante.
Dans A Geography of Dream Work and Art Therapy (2009), Monica Carpendale explore l’articulation entre creation, rêves et archétypes. Elle invite les patients à cartographier leurs paysages intérieurs – montagnes, cavernes, rivières – qui deviennent des métaphores universelles. Ces images servent de repères thérapeutiques : par exemple, la caverne comme lieu d’introspection peut donner du sens et de l’espoir à une expérience douloureuse.
Shaun McNiff, pionnier des arts-thérapies expressives, a proposé dans Art Heals (2004) et Art as Medicine (1992) une vision relationnelle des archétypes. Pour lui, l’art-thérapie n’est pas un exercice d’analyse, mais une rencontre avec « l’esprit animé » de l’image. Chaque peinture, danse ou écriture devient un allié archétypal, porteur de sagesse, à écouter et à laisser parler. Sa démarche prolonge la pensée jungienne en l’ancrant dans l’expérience vivante.
Ensemble, ces auteur·es montrent que les archétypes ne sont pas des modèles figés, mais des forces en mouvement qui dialoguent à travers les créations. L’art-thérapie, par sa nature expérientielle, offre un espace unique pour rencontrer ces figures, non pas en théorie, mais dans l’expérience directe – là où symbole, corps et imaginaire ouvrent des chemins de transformation.

Études de cas en art-thérapie avec les archétypes.
L’art-thérapeute professionnel-le ne traite pas les archétypes comme une recette à appliquer ni comme un “dictionnaire des rêves”. Les images créées en séance, lorsqu’elles font du sens pour la personne, deviennent des portes thérapeutiques. On les ouvre ensemble, au rythme de la personne, dans un cadre de bienveillance et de non-jugement. Les figures qui émergent — Ombre, Héros, Enfant intérieur, Sage — ne s’interprètent pas, elles se rencontrent, se dialoguent, puis s’intègrent dans la conscience.
L’ombre : accueillir ce qui fait peur
Une adolescente suivie pour anxiété dessinait sans cesse des images « lumineuses » — soleils, fleurs, couleurs vives — comme un voile posé sur sa frayeur. Après avoir nommé cela, l’art-thérapeute l’invite à peindre en lien avec son angoisse. Elle choisit le fusain et le pastel noir, avec geste ample sur une grande feuille. D’abord crispés, ses mouvements s’élargissent jusqu’à couvrir la feuille. Une silhouette apparaît : l’archétype de l’Ombre. En dialogue avec l’image, elle reconnaît : « C’est ma colère, je l’enfouis toujours. » La séance lui permet de sentir que cette part « obscure » n’est pas une menace, mais une énergie à apprivoiser. Son corps se relâche ; une place nouvelle se fait pour la colère, comme force de protection.

Le héros : traverser l’épreuve
Un homme de cinquante ans, en rémission d’un cancer, se dit « affaibli » et « inutile ». L’art-thérapeute remarque la trame épique de ses paroles et propose des images de magazines. Il assemble un collage avec des chemins, obstacles, montagnes : une cartographie de quête. En le regardant, il voit une traversée initiatique. Il amplifie le motif de nature sur une autre feuille ; la sensation lui est apaisante. Puis il écrit à la première personne, comme si l’image lui parlait : « J’ai survécu. Je suis soutenu. Il y a une mission pour moi. » Il identifie l’archétype du Héros, ce qui reconfigure sa fragilité en dignité, son épuisement en sagesse.
L’enfant intérieur : renouer avec le jeu
En burnout, une cliente très sérieuse n’arrive pas à lâcher prise. L’art-thérapeute l’invite à rencontrer sa part enfantine avec de l’argile souple. Elle façonne une petite créature ronde, un peu maladroite, qu’elle habille de tissus colorés. Elle se permet de sourire : « La petite veut juste jouer. » Nous ritualisons la rencontre — la figurine au centre, avec une voix et même un prénom. À la maison, elle s’accorde de courts moments de jeu sans performance ; l’élan vital revient et l’enthousiasme réapparaît. L’archétype de l’enfant intérieur réintroduit la spontanéité dans la vie de cette femme.
Le vieux sage : chercher une guidance
Un jeune adulte, perdu après avoir quitté ses études, explore les matériaux d’art dans le studio. L’encre le fascine : le liquide sur la page blanche fait naître des formes imprévisibles. En prenant du recul, un grand tronc d’arbre se révèle. L’art-thérapeute propose de le considérer comme une présence symbolique — arbre de vie, Yggdrasil, chêne sacré. En dialoguant avec l’image, il reconnaît le Sage : stabilité, enracinement, vision de sagesse. Le message qu’il entend : « Ralentis. Enracine-toi. La direction viendra d’un corps relaxé. ». Il commence à marcher régulièrement parmi les arbres du parc ; ces rendez-vous en nature l’aident à clarifier progressivement son orientation.
Ces vignettes cliniques montrent comment, en séance, l’archétype n’est pas un cliché, mais un allié vivant qui émane du processus créatif. La matière (argile, encre, fusain, collage), le geste, le regard et le dialogue tissent un pont entre l’expérience personnelle et une trame universelle. On n’« explique » rien : on écoute ce qui se présente, on amplifie, on met en mots, on laisse le corps sentir… et quelque chose se transforme.
Conclusion
En art-thérapie, le monde des archétypes permettent un langage universel, à la fois intime et collectif. Hérités de la vision de Carl Jung et revisités par des auteurs comme Swan-Foster, Silverman, Hamel, McNiff ou Carpendale, ils nous rappellent que derrière chaque création se cache une force vivante qui cherche à émerger et à nous orienter.
Dans le studio d’art-thérapie, ces figures se montrent dans un collage, un masque, un dessin spontané et parlent à la personne. Elles deviennent des alliés symboliques qui permettent d’éclairer les ombres, d’activer les ressources et d’inscrire l’histoire personnelle dans une trame plus vaste. L’art-thérapie prend alors une dimension qui dépasse la représentation: elle devient une voie de transformation et d’individuation.
Travailler avec les archétypes, c’est offrir un espace où l’acte créatif relie à la profondeur de soi et à créer du sens existentiel. C’est redonner à la psychothérapie sa dimension symbolique et poétique, là où le geste, l’image et le récit se rejoignent pour ouvrir un chemin vers l’unité. Explorer les archétypes en art-thérapie, c’est à la fois accompagner la guérison, stimuler la créativité et ouvrir un dialogue avec ce qui, en nous, appartient à l’humain universel.
BIBLIOGRAPHIE
Nous avons inclus le plus d’ouvrages possibles en français, mais parfois les livres ne sont édités qu’en langue anglaise.
Bolen, J. S, & Séjournant, M. (2018). Artémis - L'esprit indomptable en chaque femme. Courier du Livre.
Bolen, J. S. (2009). Goddesses in older women: Archetypes in women over fifty. Harper Collins.
Bolen, J. S. (1984). Goddesses in everywoman: A new psychology of women (p. 334). New York: Harper & Row.
Carpendale, M. (2021). A Geography of Dream Work and Art Therapy. Trafford Publishing.
Hamel, J. (2017). Rêves - Art-thérapie et guérison: De l'autre côté du miroir. Éditions Québec Livres.
Hillman, J. (2010). Le Code caché de votre destin. J’ai lu.
Johnson, R. A. (2008). Inner gold: Understanding psychological projection. Koa Books.
Jung, C. G., Von Franz, M. L., Henderson, J. L., Jacobi, J., & Jaffé, A. (1964). L'homme et ses symboles. Paris: R. Laffont.
Jung, C. (2024). Sur la psychologie de l'inconscient (Vol. 20). Minerva Heritage Press.
Jung, C. G. (1994). L'homme à la découverte de son âme: structure et fonctionnement de l'inconscient. Albin Michel.
Jung, C. G. (1981). The Archetypes and the Collective Unconscious (Collected Works of C.G. Jung, Vol. 9, Part 1, 2nd ed). Princeton, NJ: Bollingen
Jung, C.G. (1973). Ma vie. Souvenirs, rêves et pensées, trad. franç., recueillis et publiés par Aniéla Jaffé.
Johnson, R. A. (2009). Inner work: Using dreams and active imagination for personal growth. HarperOne
Lenoir, F. (2021). Jung, un voyage vers soi. Albin Michel
Moore, R. L., & Gillette, D. (1990). King, warrior, magician, lover. San Francisco: Harper
McNiff, S. (2004). Art heals: How creativity cures the soul. Shambhala Publications.
Myss, C., Carlino, C., & Fortier, S. (2017). Archétypes qui êtes-vous ?. Véga Editions.
Silverman, Y. (2020). The Story Within: Myth and Fairy Tale in Therapy. Jessica Kingsley Publishers
Stevens, A. (2015). Archetype revisited: An updated natural history of the self. Routledge.
Swan-Foster, N. (2018). Jungian Art Therapy: Images, Dreams and Analytical Psychology. New York : Routledge.
Von Franz, M.-L. (2007). L'interprétation des contes de fées, suivi de L'ombre et le mal dans les contes de fées. Albin Michel